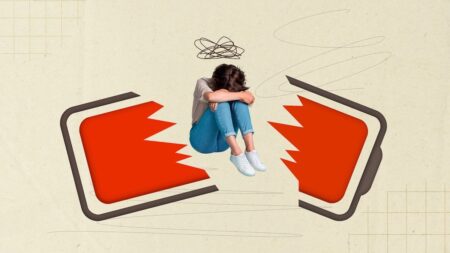Un rapport inédit, qui « lève le voile » sur les dysfonctionnements et les violences en doctorat. Ce lundi 16 décembre, l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l’Enseignement supérieur a publié son tout premier état des lieux dans le milieu doctoral. Jusqu’à présent, ce cursus à mi-chemin entre la recherche et les études représentait un « angle mort » de la lutte contre les VSS, en raison du manque de données sur le sujet.
Depuis le mois de juin 2024, l’association a interrogé près de 2100 doctorants et doctorantes. Et le constat est sans appel : plus de la moitié des étudiants interrogés (51,7%) estime que le doctorat est « particulièrement propice » aux VSS.
📣 ÉTUDE DOCTORAT « Pressions, silence et résistances »
"Le pire mécanisme dans notre milieu c'est l'impunité de ceux qui agressent"
Les résultats de notre nouvelle étude dédiée à l’enquête des #VSS et des discriminations dans le milieu doctoral : https://t.co/5UAZeul4lZpic.twitter.com/2bKnyzn9af
— Observatoire des VSS dans l’ESR (@ObservatoireVSS) December 16, 2024
Les témoignages démontrent la « récurrence, l’omniprésence et surtout la gravité des violences dans le cadre du doctorat », déplore l’organisme. Des « violences systémiques, souvent invisibles, parfois minimisées » qui existent pourtant bel et bien et qui « gangrènent le doctorat ». Elles fragilisent « non seulement les parcours académiques, mais aussi les trajectoires professionnelles et personnelles », alerte le rapport, qui révèle, sans surprise, que les femmes et les minorités de genre sont les plus touchées par ce fléau.
L’alcool, facteur déterminant dans 50% des agressions chez les étudiants
En laboratoire, sur le terrain ou en colloque : des espaces à « haut risque »
Ces violences se manifestent au sein des trois environnements caractéristiques du doctorat, nous apprend l’enquête : le laboratoire, le terrain et les colloques.
En laboratoire d’abord, « près d’un quart des répondants qui se rendent au laboratoire plus d’une fois par an déclarent y avoir subi ou avoir été témoins d’au moins une forme de violence », constate le rapport. Parmi ces VSS, le harcèlement moral et les violences psychologiques prédominent (36,1% des étudiants en sont victimes ou témoins), suivies d’agissements sexistes (17,3%), d’outrages sexistes (15,7%), de discriminations (11,1%) et de harcèlement sexuel (8,1%).
Ensuite, près de 40% des répondants ayant mené des recherches de terrain rapportent des violences ou des comportements inappropriés. Remarques obscènes (15,5% des femmes et 3,8% des hommes) et agressions sexuelles (2,8% des femmes) : les femmes et les minorités de genre sont particulièrement concernées. Et certains terrains sont plus propices que d’autres aux agressions, note le rapport. C’est le cas des terrains plus « intimes », qui ne disposent pas de régulation, ou bien de terrains collectifs (sites archéologiques ou biologiques, par exemple), qui peuvent donner lieu à une « organisation genrée et de discrimination pesant sur les femmes ».
Dernier espace à « haut risque » : les congrès et colloques. C’est dans ces lieux « essentiels au parcours académique » que 5,3% des sondés déclarent avoir subi des atteintes ou agressions de nature sexuelle. Là encore, les femmes (7,1%) et les personnes non binaires (8,9%) sont plus touchées par ce phénomène. Ce public subit par ailleurs plus de remarques méprisantes (11,4% des femmes, 14,3% des personnes non binaires, contre 4,4% des hommes). Un « climat violent » facilité par un manque d’encadrement organisationnel, souligne l’enquête.
Les femmes et les minorités de genre en première ligne
Dans cette enquête, l’Observatoire s’intéresse au profil des victimes. Il en ressort que les femmes et les minorités de genre sont surreprésentées :
- 27,5% des femmes rapportent des VSS dans leur laboratoire, contre 15,7% des hommes.
- En congrès, les agressions sexuelles sont signalées par 7,1% des femmes et par 1,1% d'entre elles dans le cadre du laboratoire.
- 40% des personnes non binaires rapportent un taux de violencesparticulièrement élevées sur le terrain, telles que des remarques sexualisantes.
Derniers constats de l’enquête : plus de la moitié des sondés considèrent que les femmes voient leur place constamment remise en cause. De plus, les VSS s’entremêlent souvent avec d’autres types de discriminations : 20% des répondants rapportent des comportements racistes dans le cadre du doctorat, souvent dirigés contre des scientifiques perçus comme non-blancs. Enfin, la maternité représente un obstacle plus important au doctorat que la paternité : 80,4% des répondants estiment qu’il est difficile d’être mère lors de son doctorat, contre 49,2% pour les pères.
Les auteurs des violences : souvent des hommes, qui ont une position d’autorité sur leurs victimes
|
Une réponse des établissements inadaptée et inefficace
Face à l’ampleur de ces violences, les dispositifs institutionnels sont inadaptés et impliquent un sous-signalement, souvent par crainte de représailles, expose l’enquête. « En congrès, par exemple, 66,9% des victimes d’agressions n’ont effectué aucun signalement et environ 24% des répondants ayant signalé ces violences rapportent un manque de soutien ou des réactions inadéquates ». Idem sur le terrain : « plus de 43% des victimes de harcèlement ignorent si des mesures ont été prises suite à un signalement et moins de 30% considèrent les dispositifs actuels efficaces ».
Dans ce contexte, l’Observatoire propose la mise en œuvre de solutions concrètes, à savoir des « dispositifs clairs, accessibles et efficaces pour accompagner les victimes, sanctionner les auteurs et prévenir durablement ces violences ». L’association de lutte contre les VSS formule 10 recommandations clés pour mieux lutter contre ces phénomènes en milieu doctoral, à savoir :
- Financer, former et structurer des postes au sein des missions égalité et lutte contre les discriminations au sein des établissements ;
- Mettre en place un cadre réglementaire pour le doctorat
- Se doter de chartes éthiques et de procédures de signalements
- Communiquer sur les dispositifs internes et externes aux établissements pour accompagner les victimes
- Sensibiliser les doctorants et former les encadrants de thèses aux VSS et aux discriminations de manière régulière et obligatoire
- Mettre en place des cellules de veille et d’écoute efficaces dans tous les établissements
- Réformer la procédure disciplinaire à l’échelle nationale pour qu’elle soit respectueuse des victimes
- Mettre en place des mesures conservatoires pour protéger les victimes et prévenir la récidive
- Clarifier les modalités d’accompagnement des établissements envers les victimes
- Établir un suivi interne de signalements (possiblement anonymes) et le rendre public.