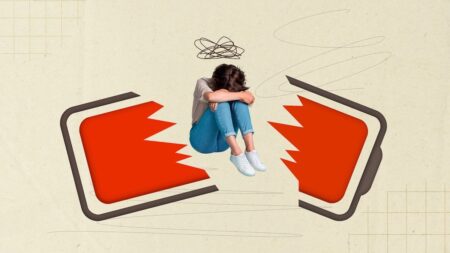Des résultats alarmants qui illustrent un fléau tristement connu. Dans le milieu étudiant, près de la moitié des violences sexistes et sexuelles (VSS) implique une consommation d’alcool. C’est la conclusion de la récente étude de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur. Menés auprès de 67 000 étudiants en France, en 2023 et 2024, les chiffres tirés de cette enquête sont sans appel.
Selon les victimes interrogées, leur agresseur a consommé de l’alcool dans la très grande majorité des cas :
- 62 % des auteurs de tentative d’agression sexuelle
- 56 % des auteurs d’agressions sexuelles
- 42 % des auteurs de tentatives de viols
- 43 % des auteurs de viols
Du côté des victimes, ces dernières étaient, elles aussi, souvent alcoolisées au moment des faits :
- 47,5 % avaient consommé de l’alcool au moment de subir une tentative d’agression sexuelle
- 44 % dans le cas d’une agression sexuelle
- 35 % dans le cas d’une tentative de viol
- 37 % dans le cas d’un viol
Un lien direct entre alcool et VSS qui met en lumière un phénomène bien connu du monde étudiant, mais encore trop souvent négligé des campagnes de prévention.
Des soirées étudiantes à haut risque
Bars, boîtes de nuit, week-ends d’intégration, voyages étudiants : c’est dans un contexte festif, en soirée, que surviennent 40 % à 50 % des VSS, nous apprend l’étude. Dans le détail, les risques d’agression sont quatre à cinq fois plus élevés entre 23 h et 3 h du matin, particulièrement les week-ends. Quant aux viols et tentatives de viols, ces agressions sont commises dans 8 cas sur 10 chez la victime ou dans la voiture de l’auteur.
Concernant le profil des victimes, les femmes sont les plus souvent agressées (71 % des victimes), suivies des personnes transgenres, non binaires et queer (33 % des victimes). Du côté des agresseurs, l’enquête estime que, dans près de 70 % des cas d’agression sexuelle et 60 % des cas de viols, les auteurs sont eux-mêmes des étudiants.
Pour les agressions sexuelles, ou tentatives d’agressions sexuelles, l’auteur est le plus souvent une personne inconnue, rencontrée depuis peu ou une simple connaissance. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un viol ou d’une tentative de viol, l’auteur est souvent le partenaire ou l’ex-partenaire de la victime (dans 50 % des cas).
Mieux lutter contre les VSS
Pour les auteurs de l’enquête, ces résultats sont une « alerte sérieuse », qui nécessitent d’aller plus loin dans la lutte contre les VSS. Car, si des mesures concrètes sont déjà déployées, comme le Plan national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, force est de constater que les agressions sont toujours là. Et celles-ci ne sont pas assez souvent suivies de dépôts de plainte, selon l’enquête.
En effet, seuls 2,9 % des cas d’agression sexuelle et 7,9 % des cas de viols ont conduit à un dépôt de plainte. Une proportion divisée par deux lorsque les victimes d’agression sexuelle ou de tentative d’agression sexuelle ont consommé de l’alcool. En revanche, dans le cas d’un viol, les victimes qui étaient alcoolisées portent plus facilement plainte (9,7 %) que celles qui ne l’étaient pas. À noter que la consommation d’alcool de la victime ou de l’agresseur est une circonstance aggravante dans le cas d’une VSS.
Dès lors, il est plus que nécessaire de renforcer la prévention en milieu universitaire, insistent les chercheurs signataires de l’étude. Il est aussi urgent, selon eux, d’apporter plus de réponses administratives et judiciaires en cas d’agression. Pour lutter contre ce fléau, il faut donc non seulement impliquer les établissements, associations et autorités, mais aussi inciter à une meilleure régulation de la consommation d’alcool.
C’est d’ailleurs ce que font déjà les établissements de la Conférence des grandes écoles, qui ont signé un partenariat l’an dernier avec la Midelca. « Faire la fête et célébrer sans abuser de l’alcool est un mouvement global de société qu’il faut encourager afin notamment de protéger les étudiants, en particulier les jeunes femmes », fait valoir le docteur Nicolas Prisse, président de la MIDELCA.