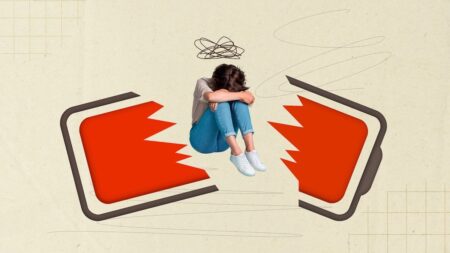Dans les salles de cours, sur les campus, dans les espaces partagés : là où la vie étudiante bat son plein, beaucoup paraissent tranquilles. Mais derrière un sourire ou un “ça va” prononcé trop vite, ils sont nombreux à souffrir en silence.
Les chiffres le confirment : selon le dernier baromètre BVA sur la santé de la communauté estudiantine, 3 étudiants sur 5 présentent des signes de détresse psychologique. Un chiffre presque deux fois supérieur à celui observé dans la population française (36 %). Seuls 45 % des étudiants disent aujourd'hui être en bonne santé mentale.
Santé mentale et études : 4 chiffres pour comprendre le mal-être grandissant des étudiants
Bien que reconnue comme une grande cause nationale depuis la crise sanitaire, la santé mentale des jeunes continue de vaciller. Face à ce mal silencieux qui gagne du terrain, les établissements d’enseignement supérieur s'efforcent de bâtir des digues, pierre après pierre. Quels sont leurs moyens et les dispositifs déployés ? À l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale ce vendredi 10 octobre 2025, Diplomeo a mené l’enquête.
Une urgence devenue visible
Stress, isolement, anxiété… autant de facteurs qui pèsent sur le quotidien d'une génération sous pression. Depuis la crise du Covid, ce mal-être, longtemps resté dans l’ombre, s'est imposé comme un enjeu central dans l'enseignement supérieur. Mais pour certains experts, la prise de conscience ne date pas d’hier. « Avant le Covid, un tournant s’est amorcé il y a environ dix ans. Quand je suis arrivé dans l’enseignement supérieur, en 2019, on parlait déjà beaucoup de ces sujets », confie Hadrien Robidas, responsable des politiques de prévention à l’ESSCA School of Management.
Puis, les lignes ont commencé à bouger. La pandémie a agi comme un révélateur, braquant la lumière sur une réalité déjà bien installée. « On observe aujourd’hui une explosion des troubles chez les 18-25 ans », confie Céline Moutarde, infirmière des étudiants au sein de Y SCHOOLS. « Pendant le Covid, ils n’ont pas vécu une adolescence normale, avec moins de liens sociaux. Ce qui a entraîné de l’anxiété, du stress et de l’angoisse à l’entrée dans l’âge adulte », ajoute-t-elle.
Depuis, la santé mentale s'est imposée progressivement dans le débat public. Les témoignages se multiplient et les médias s'en emparent. Ce qui n'était encore qu'un sujet tabou il y a quelques années est devenu un enjeu sociétal majeur, au même titre que la précarité étudiante ou les violences sexistes et sexuelles.
Des dispositifs nationaux utiles, mais déjà sous tension
Face à l'ampleur du malaise étudiant, l'État a dû réagir. En 2021, à l'issue de la crise sanitaire, il tente de poser un premier pansement : le dispositif « Santé Psy Étudiant ». Son objectif : permettre à tout étudiant en détresse psychologique — qu'il s'agisse d'angoisse, de dépression, d'addiction ou d'autres troubles — d'accéder gratuitement à un suivi. Maintenu cette année encore, le programme s'est renforcé : depuis le 1er juillet 2024, le nombre de séances gratuites avec un psychologue partenaire est passé de 8 à 12.
Un soutien essentiel à un moment de vie souvent marqué par la pression académique, l'isolement ou l'incertitude face à l’avenir. L'accès au dispositif reste simple : une inscription sur le site gouvernemental dédié permet aux étudiants de trouver un psychologue partenaire et d'obtenir toutes les informations nécessaires. Il existe aussi d'autres dispositifs nationaux comme Apsytude ou « Ma Santé Psy », avec une prise en charge à 100 % par l'Assurance maladie.
Étudiant : à qui m'adresser si je suis en détresse mentale ?
Les étudiants sont conscients et bien informés sur les dispositifs de soutien psychologique. À CY Cergy Paris Université, la vice-présidente de la vie étudiante Peggy Blin Cordon, également enseignante-chercheuse, constate au quotidien une meilleure attention portée à ces questions. Le dispositif Santé Psy étudiant, souvent appelé « chèque psy », est bien identifié par les étudiants, « car très bien relayé par le Service santé étudiant (SSE) », précise-t-elle, avant de tempérer : « Il fonctionne, mais malheureusement parce que la demande est forte ».
« Le système de santé public est saturé, il y a des délais pouvant aller jusqu'à 18 mois pour un psychiatre », Peggy Blin Cordon, vice présidente de la vie étudiante à CY Cergy Paris Université
Cette forte demande illustre une réalité préoccupante : les besoins explosent plus vite que les capacités d'accueil. Les dispositifs nationaux, bien qu'efficaces, peinent à absorber l’ensemble des sollicitations.
Résultat des courses : des délais d'attente longs, des professionnels surchargés et des établissements contraints d'innover pour répondre à l'urgence. « Le système de santé public est saturé, il y a des délais pouvant aller jusqu'à 18 mois pour un psychiatre », déplore la vice-présidente de la vie étudiante. C'est dans ce contexte que plusieurs écoles et universités ont choisi de développer leurs propres dispositifs de soutien, souvent en complément du cadre national.
Repérer les premiers cris silencieux
Avant de proposer un accompagnement adapté, les différents interlocuteurs des établissements doivent d'abord apprendre à repérer les premiers indices de mal-être chez les étudiants. « Les signaux d'alerte peuvent être divers », analyse Peggy Blin Cordon. « Un étudiant peut venir de lui-même demander une consultation psychologique, être repéré par un enseignant — par exemple en cas de baisse des notes importante — ou, plus fréquemment, présenter un absentéisme régulier. C'est un indicateur qui ne trompe pas », poursuit-elle.
Dans le détail, ces signes peuvent se manifester par de multiples facteurs : isolement, pression sociétale, anxiété, éloignement dû aux études à l'international, charge financière croissante, troubles dépressifs ou encore consommation de substances. Autant d'éléments qui, pris ensemble, dessinent souvent le portrait d'un étudiant en difficulté.
Santé mentale des étudiants : 5 conseils simples pour prendre soin de soi pendant les études
Mais les tracas estudiantins ne se limitent pas aux seuls indicateurs scolaires ou comportementaux. Comme le souligne Vanessa Ntakabanyura, psychologue des étudiants à l'ESSEC Business School, l'anxiété est liée à la performance dans un environnement compétitif et exigeant, très présent dans les écoles de commerce. « Il y a aussi la vie quotidienne qui peut peser lourd : difficultés à trouver sa place dans les associations, à se faire des amis, prise de parole en travaux de groupe, rupture amoureuse… Tout cela fait partie des problématiques que nous prenons en charge au quotidien », égrène-t-elle.
« Un étudiant qui ne se sent pas bien, qui n'est pas placé dans de bonnes conditions, aura forcément du mal à s'épanouir et à réussir », Cédric Loison, responsable de la vie étudiante à Y SCHOOLS.
Psychologues, cellules d'écoutes, consultations : les établissements proposent un large éventail de services
Les signaux d'alerte sont là, mais comment les établissements y répondent-ils vraiment ? Derrière les murs des campus, des dispositifs concrets voient le jour. « Parce qu'un étudiant qui ne se sent pas bien, qui n'est pas placé dans de bonnes conditions, aura forcément du mal à s'épanouir et à réussir », rappelle Cédric Loison, responsable de la vie étudiante à Y SCHOOLS.
Parce qu'en parler, c'est souvent le premier pas pour desserrer ce nœud invisible autour de la poitrine, les universités et écoles ont déployé plusieurs solutions : permanences psychologiques gratuites, cellules d'écoute, consultations individuelles et même téléconsultations. Ces initiatives visent à offrir un soutien accessible et immédiat, pour accompagner les étudiants dès les premiers signes de détresse.
Comment gérer l'anxiété et la dépression pendant ses études ?
À l’ESSCA, la cellule d'écoute fait désormais partie du paysage étudiant. « Nous avons créé la cellule en 2011, après le suicide d'un étudiant. Elle a d'abord concerné les campus d'Angers et de Paris avant de s'étendre à l'ensemble du réseau », précise Hadrien Robidas. Aujourd'hui, chaque campus de l’école de management dispose d'une psychologue référente.
Le dispositif, 100% gratuit et financé directement par la business school, est ouvert à tous les étudiants, y compris ceux en césure ou à l'étranger. « Il fonctionne toute l'année, même pendant les vacances estivales », insiste le responsable des politiques de prévention. Chaque année, des points sont réalisés pour identifier les problématiques émergentes et adapter les actions. « Par exemple, à Lyon, on a organisé des ateliers sur les addictions tandis qu'à Bordeaux, on a opté pour des campagnes contre le harcèlement. Nous savons que nous n'éradiquerons pas ces problèmes, mais nous faisons le maximum pour nos étudiants », détaille-t-il.
Certaines écoles vont plus loin en sondant régulièrement le moral de leurs étudiants. C’est le cas de l’École de Biologie Industrielle (EBI), qui a mis en place un baromètre interne permettant à chacun de s'exprimer sur son état général. Un outil à la fois simple et précieux, qui sert aussi de porte d'entrée discrète vers un accompagnement. « L'année dernière, deux cas précis ont été signalés via ce baromètre. Nous avons pu les accompagner », confirme Aurélie Fremaux, responsable de l'expérience étudiante à l'EBI.
Mais la prévention ne s'arrête pas là. À l'EBI, elle passe aussi par la formation et les partenariats associatifs. L'école collabore notamment avec Nightline et Addiction France, afin de former les étudiants à repérer les signaux de mal-être et à savoir comment réagir. La formation Nightline, basée sur le volontariat, se déroule sur une soirée et une journée complète, dans un format intimiste réunissant une dizaine de participants. L'objectif : créer un espace de parole et de sensibilisation où chacun apprend à écouter sans juger, ni se substituer à un professionnel.
Du côté de Y SCHOOLS, la prévention prend aussi racine dans le dialogue et les partenariats. L’établissement collabore aussi avec Addiction France pour aborder sans tabou la question des conduites addictives, souvent étroitement liées à la santé mentale. « La consommation de substances peut aggraver ou déclencher une pathologie psychiatrique. Le partenariat offre un espace de dialogue au plus près des étudiants sur leurs conduites addictives, parfois inconscientes », expliquent Céline Moutarde et Cédric Loison.
Le dispositif, lancé il y a un an, entre aujourd'hui dans sa deuxième année. Le volume de prises en charge reste encore limité, bien que chaque accompagnement compte. « Ce type d'action s'évalue dans la durée : il faut du temps pour que la confiance s'installe », précisent-ils.
Enfin, l’EBI organise des ateliers de gestion du stress au ton volontairement léger. « On ne l'avait pas présenté comme un atelier sur le stress, mais comme une invitation à tester son niveau de stress », sourit Aurélie Fremaux.
La CVEC : un levier efficace pour financer ces dispositifs
Derrière ces initiatives, un levier très connu des étudiants joue un rôle clé : la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC). Cette contribution, dont les étudiants doivent s'acquitter chaque année, est inhérente au financement des dispositifs de santé mentale sur les campus.
C'est notamment le cas à CY Cergy Paris Université, où la CVEC a clairement changé la donne. « Nous avons fait le choix de donner les moyens au SSE pour recruter des psychologues, faire intervenir un psychiatre et financer des ateliers de prévention », détaille la vice-présidente de la vie universitaire. « La prise de rendez-vous est simple, dématérialisée et anonyme : c'est crucial pour simplifier le parcours d'un étudiant en mal-être », souligne-t-elle.
La contribution étudiante au sein de l’université francilienne a aussi permis le déploiement de dispositifs spécifiques comme Sérénétude : un programme proposé avant chaque session de partiels, avec des ateliers de sophrologie, d'acupuncture ou de gestion du stress. Un moyen de désamorcer la pression des examens… tout en repérant parfois des situations plus profondes qu'une angoisse passagère.
Même constat à Y SCHOOLS, où la CVEC a profondément transformé la politique de santé. « Avant, les moyens alloués à la vie étudiante étaient très limités. La CVEC a radicalement changé la donne : elle a permis de multiplier les actions et de recruter, notamment des psychologues et des heures de psychiatre », explique Cédric Loison.
Mais encore faut-il que les étudiants sachent à quoi elle sert. « Il faut être transparent avec les étudiants sur la CVEC : il s'agit de leur argent. Il faut donc leur expliquer comment les fonds sont utilisés », insiste Cédric Loison.
| Santé mentale : le bien-être comme boussole Prendre soin de la santé mentale des étudiants passe aussi par le bien-être au quotidien. C'est dans cet esprit que l'ESSEC développe des initiatives en ce sens à travers le programme Feel Good, qui vise à offrir des soins pour le bien-être. Selon la psychologue des étudiants, le service santé Feel Good propose des spécialistes pour accompagner l'étudiant : ostéopathe, diététicienne, infirmière, médecin, autant d'approches pour répondre à ses besoins. « Le service psychologique répond aussi en cas de deuil, de rupture amoureuse, et plus largement à tout ce qui empêche l'étudiant de se sentir bien et de mener à bien des études de haut niveau, précise Vanessa Ntakabanyura. « Tout ne relève pas de la dépression ou de l'anxiété : le service psycho couvre l'ensemble de ces situations. » |
Le rôle des associations : qui de mieux que les jeunes pour parler aux jeunes ?
En plus des écoles, les associations tentent d'apporter leur pierre à l’édifice. À l’origine du service civique, l'association Unis-Cité mobilise chaque année des milliers de jeunes de 16 à 25 ans. « Ils travaillent sur des missions d'intérêt général, en équipe de jeunes très variés », précise Marie Trellu-Kane, fondatrice et présidente d'Unis-Cité.
En 2024-2025, 6 500 jeunes sont engagés dans toute la France, dont environ 450 sur des actions de prévention santé mentale en pair-à-pair. Leur mission : aller vers d'autres jeunes, parler de santé mentale sans tabou, sensibiliser à la diversité des situations et orienter, si besoin, vers les bons relais.
Pour assurer la qualité des interventions, Marie Trellu-Kane affirme que les volontaires sont formés par des structures expertes. « Cela peut être des psychologues, des psychiatres… Le principal partenaire, c'est l’Action et recherche handicap et santé (ARHM) avec qui on a monté le programme Ambassadeurs sentimentaux : des jeunes ambassadeurs qui parlent santé mentale à d'autres jeunes », détaille la présidente d'Unis-Cité. Aujourd'hui, l'association est présente dans dix grandes agglomérations et prévoit d'étendre le dispositif sur l’ensemble du territoire.
« Les établissements ne peuvent pas se substituer aux professionnels de santé »
Les écoles et universités ont pris conscience de l'urgence : la santé mentale n'est plus un sujet tabou, mais un véritable enjeu collectif. Pour autant, l’équilibre reste fragile, car « les établissements ne peuvent, ni ne doivent, se substituer aux professionnels de santé ».
Pour Cédric Loison de Y SCHOOLS, la priorité est de penser le temps étudiant autrement.
« Il faut imaginer des phases de décompression pour des étudiants qui ont la tête dans le guidon entre études, écrans et réseaux sociaux. Donner des moyens aux associations sportives et culturelles pour évacuer le stress et favoriser l'épanouissement », préconise-t-il.
Pour la psychologue des étudiants de l'ESSEC, le message est clair : il faut créer un environnement où les étudiants se sentent autorisés à demander de l'aide sans crainte d'être jugés. « Les problématiques ne sont pas toujours la faute de la personne. Parfois, elle réagit normalement à un contexte compliqué », explique Vanessa Ntakabanyura. « L'école doit être un relais : pour qu'un étudiant aille voir le psy, il doit sentir que cela n'altère pas le regard académique porté sur lui », renchérit-elle.
« On ne peut pas commencer à trop proposer, car après les étudiants commencent à penser qu'on peut offrir certaines choses, et quand on ne le fait pas, ça peut générer de la frustration », Hadrien Robidas, responsable des politiques de prévention à ESSCA School of Management
Même constat à l'ESSCA, où le responsable des politiques de prévention insiste sur la nécessité de trouver un juste milieu. « Il y a des moments où l'on ne peut pas tout faire. En termes de dispositifs avec les psychologues, on ne peut pas commencer à trop proposer, car après les étudiants commencent à penser qu'on peut offrir certaines choses, et quand on ne le fait pas, ça peut générer de la frustration », constate Hadrien Robidas. L'école peut transmettre des repères, mais ne peut pas tout contrôler.
Mais au-delà de la prise en charge, l'école se positionne comme un acteur de prévention et de socialisation. « On intervient à un moment important des étudiants car on forme des jeunes adultes qui quittent le nid familial et vont avoir leurs premières galères. On est un nouvel intermédiaire. C'est le message que l'on veut faire passer : la famille forme un individu, nous on forme un collectif », ajoute-t-il.
Enfin, pour que le bien-être des étudiants devienne une vraie priorité, il faut aussi former les adultes encadrants. Pour Hadrien Robidas, beaucoup d'enseignants ne sont pas toujours conscients des signaux de détresse, et cela peut parfois « empirer les situations », alors qu'elles auraient pu être évitées. « Changer la culture d'une école, ça prend du temps : ce sont des enjeux profonds ».