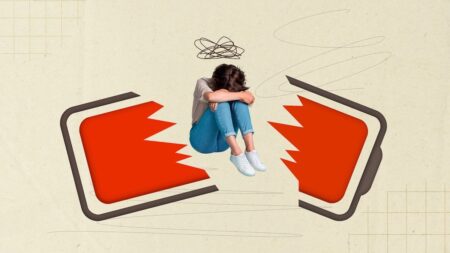C’est dans les années 1990 que le sigle « LGBT » apparaît pour la première fois. Le terme « gay », considéré comme trop restrictif, est remplacé par cet acronyme qui englobe les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Depuis quelques années, on parle davantage de communauté « LGBTQIA+ », qui inclut les queers, intersexes et asexuels, ainsi que toutes les orientations sexuelles et identités de genre qui ne se reconnaissent pas dans un schéma binaire.
En 2020, l’association SOS homophobie a recensé 76 cas de LGBTIphobies en milieu scolaire et dans l’enseignement supérieur. À une échelle plus large de la population, cela représente 4 % des situations rapportées. Sur 55 cas spécifiques, la grande majorité des victimes a moins de 18 ans (69 %) et 56 % d’entre elles sont des hommes cisgenres*.
Autres indicateurs importants : si plus de la moitié des agressions anti-personnes homosexuelles sont l’œuvre d’élèves, une sur cinq est imputée à des membres de la direction des établissements et du personnel non enseignant. Ces discriminations se manifestent principalement par le rejet (73 %), les insultes (56 %) et le harcèlement à 51 %.
Vous vous demandez que faire en cas de discriminations ou violences en raison de votre orientation sexuelle ou identité de genre ? Vers qui vous tourner si vous avez besoin de soutien ? Que dit la législation ? Toutes les réponses sont dans cet article !
Vous avez le droit d’exister : la loi vous protège
« La haine, le mépris et le rejet des personnes LGBT constituent une discrimination punie de 3 à 5 ans de prison et de 45 000 à 75 000 € d’amende. La victime peut saisir le Défenseur des droits, s’adresser au bureau d’aide aux victimes ou déposer une plainte. En cas de crime ou délit, le mobile homophobe ou transphobe est une circonstance aggravante. », peut-on lire sur le site Justifit, qui regroupe des avocats spécialisés. En d’autres termes, cela signifie que ce type de discrimination est sévèrement puni par la loi.
Mais c’est quoi exactement une LGBT-phobie ? Il s’agit de tous les comportements anti-homosexuels, bisexuels, trans' ou toutes autres minorités. Elle peut se manifester sous plusieurs formes : attitudes hostiles en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, haine des personnes LGBT+, etc.
Au niveau de l’État, un plan national d’actions pour l’égalité des droits contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ se déploie depuis 2020 jusqu’en 2023. Il a été porté par Élisabeth Moreno, ex-ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. Plus de 150 mesures concrètes ont été annoncées comme une priorité de son ministère ainsi que de la DILCRAH (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT).
Dans le courant de cette action interministérielle, un guide pour lutter contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ dans l’enseignement supérieur a été publié. Il a pour vocation d’accompagner les établissements dans la mise en place d’actions de prévention, de sensibilisation et de lutte contre les LGBTphobies. Ce document s’adresse à l’ensemble du personnel travaillant auprès des populations étudiantes. C’est aussi une ressource à disposition des étudiants qui leur rappelle leurs droits et leurs obligations.
Autre outil : un kit de prévention des discriminations réalisé par la CPED (Conférence permanente des chargés de mission égalité diversité) et l’AFMD (Association française des managers de la diversité), avec le soutien du Défenseur des droits, du MESR (ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) et de JuriSup, réseau professionnel de responsables des affaires juridiques de l’enseignement supérieur. À noter qu’il s’adresse avant tout au secteur public.
Vous avez le droit de changer d’identité ou de garder l’anonymat
Pour accompagner les établissements d’enseignement supérieur à mieux inclure les étudiants transgenres, le MESR a annoncé plusieurs mesures en 2019.
Une incitation au niveau national
Parmi ces mesures phares : le prénom d’usage est désormais reconnu pour l’inscription depuis la rentrée 2019.
Voici une liste non exhaustive des documents qui peuvent mentionner le prénom d’usage sans besoin de modification du prénom à l’état civil :
- la carte étudiante
- la carte de bibliothèque
- les listes électorales
- les listes d’émargements
- les listes de candidats
- l’affichage des résultats d’examen
- l’adresse de messagerie étudiante
Liste non exhaustive des documents qui nécessitent une modification du prénom à l’état civil pour être considérés comme prénom d’usage :
- le diplôme
- les contrats doctoraux
- les contrats de travail
- le relevé de notes individuel
- l’attestation de réussite
- le certificat de scolarité
Si vous en faites la demande, et une fois votre prénom officiellement modifié, votre établissement sera dans l’obligation de rééditer les diplômes éventuellement délivrés avec l’ancien. Pour effectuer la démarche, renseignez-vous auprès de celui-ci ou sur le site service-public.fr.
Autre changement : les mentions « Madame/Monsieur » sont facultatives. De ce fait, elles pourront être supprimées des correspondances, formulaires et autres documents internes. Celles qui figurent encore dans les modèles de diplômes nationaux et de certains diplômes d’État pourront être rayées sur simple demande de votre part.
Un respect qui se concrétise sur les campus
Plusieurs établissements s’impliquent concrètement pour faire appliquer les recommandations de l’État et éradiquer les VSSH (Violences sexistes sexuelles et homophobes) de leurs murs.
À la fois dans les universités publiques…
À l’université de Strasbourg, le message est clair : « Ils ont les mêmes droits que tout étudiant, ils ont le droit d’étudier sereinement, d’évoluer dans le cadre, tout comme tout autre étudiant et donc d’utiliser, s’ils le souhaitent, un prénom d’usage qui sera reconnu dans leurs courriels, dans leur carte d’étudiant, dans les listes d’émargements. », assure Isabelle Kraus, vice-présidente égalité, parité, diversité de l’université alsacienne. Selon elle, l’orientation sexuelle est un élément que son institution ne questionne jamais. De plus, l’Unistra communiquerait à l’ensemble de ses associations à propos de la possibilité de former leurs membres aux VSSH.
« L’étudiant qui a envie de changer de prénom se présente devant son service de scolarité à tout moment de l’année. » Pascal Tisserant, maître de conférences à l’université de Lorraine, l’identité de genre est un grand sujet depuis plusieurs années selon Pascal Tisserant, maître de conférences, vice-président égalité - diversité – inclusion. « Pendant longtemps, quand les étudiants voulaient changer de prénom, ils se heurtaient à l’administration qui évoquait notamment des raisons techniques. Ce n’est plus le cas depuis trois ans, puisque la ministre précédente (Frédérique Vidal, NDLR) a fait changer le système informatique qui permet justement de dépasser ce problème », relate-t-il.
Il précise qu’une lettre a été envoyée au président de l’université en demandant de prendre en compte et satisfaire cette requête. « On ne demande ni formulaire, ni questionnaire, ni entretien spécifique avec un psychologue. L’étudiant qui a envie de changer de prénom se présente devant son service de scolarité à tout moment de l’année et on lui édite une nouvelle carte d’étudiant. Le changement se fait automatiquement dans les listes d’appels. », insiste-t-il.
… et dans les écoles privées
Vivre librement son orientation, être entendu et accompagné : c’est ce que propose Montpellier Business School, entre autres. « Depuis quelques années, la question du prénom d’usage revient au niveau du formulaire d’inscription. Compléter une case non genrée quand on demande le sexe d’un étudiant, c’est un traitement administratif qui n’est pas très compliqué à mettre en place », explique Benjamin Ferrand, responsable RSE et développement durable.
Selon ses dires, il s’agit pour MBS de montrer son investissement. La seconde étape est d’aller voir tous les étudiants classe par classe, ce qu’il s’attache personnellement à faire à chaque rentrée pour leur expliquer qu’ils ont des droits. « Au-delà d’une bienveillance qu’on leur demande entre eux, on est particulièrement à l’écoute et attentif sur les situations d’exclusion que pourraient ressentir certains par rapport à leur orientation sexuelle, par rapport à un handicap, par rapport à un critère de diversité quel qu’il soit. », conclut-il.
Même son de cloche chez Kedge Business School : « On a une cellule de signalement qui garantit une anonymisation totale de toutes les données et on a aussi fait distribuer un questionnaire anonyme à l’ensemble de nos salariés, de nos étudiants et étudiantes à propos de leur perception de l’inclusivité au sein de l’école », soutient Anicia Jaegler, doyenne associée à la durabilité et inclusivité.
L’inclusivité est justement sur toutes les lèvres depuis quelques années, mais il n’est pas toujours aisé d’appliquer ses principes et ses lois sur le terrain.
Vous avez le droit au respect et à la bienveillance
Si la loi encadre peu ou prou ce qui peut être cadré, un soutien et un engagement à la fois éthique et moral ne sont jamais de refus. Surtout quand on sait qu’un regard insistant ou des mots déplacés qui surgissent subtilement et régulièrement dans une conversation peuvent être durs à prouver.
En cela, la charte d’engagement LGBT+ de l’enseignement supérieur, signée le 13 octobre dernier, est un témoignage de bonne volonté de la part des responsables pédagogiques. Par celle-ci, les établissements s’engagent dans les grandes lignes à :
- créer un environnement inclusif pour le personnel, les enseignants et les étudiants LGBT+
- veiller à une égalité de droit et de traitement quelle que soit l’orientation sexuelle ou l’identité de genre
- soutenir le personnel, les enseignants et les étudiants victimes de propos ou d’actes discriminatoires
- mesurer les avancées et partager les bonnes pratiques pour faire évoluer l’environnement professionnel et le cadre d’études dans l’enseignement supérieur.
Pour l’élaborer, l’Autre Cercle, organisme qui en est à l’initiative, s’est associé au Caélif (Collectif des associations étudiantes LGBT+ d’Île-de-France) et à la FAGE (Fédération des associations générales étudiantes).
« On a regardé le baromètre 2020 du Caélif et parmi les chiffres assez criants : 1 étudiant LGBT+ sur 10 a été victime de LGBTphobies dans son établissement, 85 % d’entre eux ne rapportent pas les faits à l’administration », déplore l’Autre Cercle, qui affirme que ces agissements viennent tout autant d’autres étudiants que de professeurs ou de l’administration elle-même.
Toutefois, ce baromètre décrit un « climat plutôt favorable », puisque 28 % des répondants ont rapporté avoir connaissance de politiques spécifiques de leur établissement pour les personnes LGBT+. Dans la région francilienne, ce pourcentage atteint 36,5 %. Les sondés sont 35 % à considérer leur administration ouverte et/ou engagée sur la question des droits LGBT+.
Des résultats insuffisants pour le responsable de la charte, qui a aussi été créée pour prévenir dès la période des études plutôt que guérir une fois les étudiants insérés sur le marché de l’emploi. « Plein d’employeurs s’engagent en signant la charte et veulent créer un environnement de travail bienveillant, inclusif. Ils s’attendent aussi à ce que les écoles forment les collaborateurs et les leaders bienveillants, inclusifs de demain », rapporte Charles-François Perrone.
Avant la signature, un gros travail est fait en amont avec chaque établissement pour les préparer notamment à créer un plan d’action à destination de leurs employés, des enseignants et de leurs étudiants. « Je les challenge un peu, puis on signe pour trois ans et on renouvelle après avoir fait le point sur les avancées. Si on voit que rien n’a été fait, on se réserve le droit de lever leur titre de signataire. », complète le responsable.
Vous avez le droit d’être visible
À la fois juge et témoin en tant que personne homosexuelle : avec l’élaboration de la charte, Charles-François Perrone a tenu à encourager établissements et employeurs à être proactifs pour mettre en confiance leurs étudiants, employés et équipes pédagogiques. Le discours est qu’ils peuvent être qui ils sont sans craindre d’être discriminés.
Lors de ses études et jusqu’à la vie active, les violences plus ou moins explicites l’ont empêché de se sentir lui-même : « La première fois qu’on a essayé de me taper parce que j’étais gay, j’avais 11 ans. J’ai appris très tôt la violence que pouvait engendrer la différence. Et j’ai appris aussi très tôt à ne plus être moi-même, à me cacher ». Des réflexes qui accentuent le risque de s’auto-exclure socialement, par peur de la réaction des autres. « Toute cette énergie qu’on met à se cacher, c’est de l’énergie qu’on ne met pas forcément dans ses études ou dans son travail », regrette-t-il.
Dans le plan d’action de la charte, un système de remontée des cas de discrimination, par mail ou via un formulaire en ligne, est demandé. Les établissements doivent rédiger un process et définir une sanction qui peut aller d’un rappel à l’ordre à une exclusion, selon la gravité. En outre, l’article 1.d suggère d’identifier un référent. Il s’agit de mettre en place des ambassadeurs et ambassadrices diversité-inclusion qui travaillent sur la mise en œuvre du plan.
Vous avez le droit à des évènements dédiés
Chaque année, la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, qui se tient le 17 mai, donne lieu à toute une série d’événements. À l’université de Lorraine, c’est aussi à cette période que se déroule la semaine ou le mois des fiertés (gay pride, gay month ou marche des fiertés) auxquels elle est associé. À l’occasion, elle transforme son isotype avec des couleurs du drapeau arc-en-ciel, jusque sur le réseau professionnel LinkedIn.
En effet, la charte demande aux signataires de mentionner explicitement les thématiques LGBT+ dans les communications internes sur les engagements en faveur de la non-discrimination et de la diversité.
Plus récemment, une composante de l’UFR sciences humaines et sociales de Metz a organisé un événement à l’occasion de la journée de la visite du souvenir de la visibilité sur la question de la transidentité. Une école d’ingénieurs a, quant à elle, fait appel à une association locale appelée « Couleur gaies ». Cette année, pour la première fois, ils ont formé tous leurs étudiants à ces problématiques.
Vous avez le droit d’être recruté. e de manière indiscriminée
À l’EM Normandie, l’approche se veut un poil plus large que le volet LGBT. « On est en train de déployer un plan d’action de lutte contre les discriminations, quelles qu’elles soient. Ça passe par le fait de recruter sans discriminer. On veut avoir des sessions spécifiques sur les micro-agressions involontaires que tout un chacun pourrait faire subir. », dévoile Julien Soreau, responsable service équilibre et inclusion et responsable groupe handicap de la CGE (Conférence des grandes écoles).
D’après lui, il y a encore beaucoup de zones d’ombre et d’inconnues qui génèrent des micro-agressions, voire quelquefois, du rejet. Cependant, il observe plus de réticence à propos de la transidentité que par rapport aux trois autres volets.
En Lorraine, la signature de cette charte s’inscrit dans une politique plus générale d’égalité diversité et inclusion que l’université a également adoptée depuis 2015. Cette dernière s’appuie sur des critères de discrimination qui incluent la question de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. Le vice-président égalité - diversité - inclusion le stipule : « Nous avons fait le choix de nous ouvrir à d’autres critères, incluant ces deux éléments que la charte de l’Autre Cercle couvre pleinement. »
En école de commerce, comme en faculté, l’inclusivité est au cœur de toutes les préoccupations. À Kedge c’est l’un des piliers, affirme Anicia Jaegler : « On a une rentrée spéciale inclusivité côté étudiants, et en même temps, on a formé la partie administrative et professorale qui participe à ces journées d’intégration.On a régulièrement des formations ou événements sur ces sujets pour sensibiliser et former l’ensemble des salariés. » 64 associations sont formées et tenues à une tolérance zéro par rapport à toute discrimination.
Vous avez le droit d’être entendu. e/écouté. e
De son côté, MBS était déjà engagée avec l’Autre Cercle, en plus d’être titulaire des labels égalité et diversité de l’Afnor depuis 2009. « L’idée, c’est d’aller plus loin que ce qu’on fait déjà avec les collaborateurs, pour intégrer l’accompagnement, la sensibilisation et la formation des étudiants. », relate Benjamin Ferran.
Le droit à du personnel formé pour vous entendre…
La vingtaine d’associations étudiantes dont dispose la Business school intervient auprès des membres de différents bureaux pour les sensibiliser à plusieurs enjeux en lien avec l’engagement diversité de l’école. Au total, les étudiants ont trois possibilités pour que la situation soit entendue et traitée par l’école montpelliéraine :
- l’écoute entre pairs via l’association Caribous
- l’écoute via des juristes ou psychologues
- l’écoute via le personnel de l’administration formé pour accompagner ces situations
Tous ces dispositifs sont gratuits. « Il est hors de question que quelqu’un soit frustré ou vive de façon cachée parce qu’il ne se sent pas écouté ni accompagné par l’établissement et par ses camarades. », assène le responsable RSE.
… mais aussi le droit de signaler un manquement aux règles
Et en cas de signalement, que se passe-t-il ? « Une cellule d’écoute se met en place avec une psychologue pour les personnels », rassure Pascal Tisserant. « On vient de recruter un psychologue spécialement pour les étudiants, qui fait ce premier travail d’écoute. Ensuite, il y a un pré-rapport qui passe devant une commission. », poursuit-il. Si la situation est jugée grave, une alerte est donnée au procureur dans les 24 h.
S’il y a signalement d’une atteinte à votre homosexualité, bisexualité ou autres à Kedge, une enquête s’établit avec les différents commissariats des campus concernés. « L’année dernière, on a eu 29 signalements, surtout venant de la communauté LGBT. » informe Anicia Jaegler. Ces chiffres en augmentation sont en réalité positifs selon la doyenne, car ils prouvent que la parole se libère.
*une personne cisgenre est une personne dont le genre actuel correspond à celui assigné à la naissance, qu’elle soit attirée ou non par des personnes de même sexe.