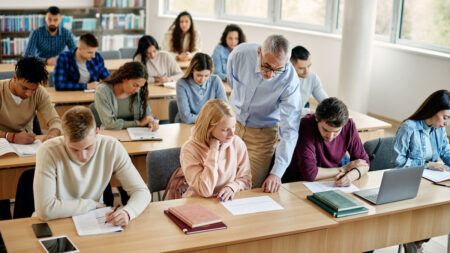Dans les études supérieures, le système licence-master-doctorat (LMD) a été mis en place en 2004. Une architecture des diplômes universitaires que l’on distingue en trois grandes parties : la licence (du bac à bac+3), le master (bac+5) et enfin, le doctorat (bac+8).
L’objectif ? Harmoniser les diplômes de l’enseignement supérieur à travers les pays européens, notamment pour favoriser la mobilité des étudiants, comme le prévoit le processus de Bologne. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le système LMD !
Du processus de Bologne au système LMD
Le système LMD est directement inspiré du modèle européen de la Déclaration de Bologne, qui a été signée en 1999 par tous les ministères de l’Enseignement supérieur des 29 pays du Vieux continent.
Un processus fondé sur six objectifs distincts :
- des diplômes lisibles et comparables
- la structuration des études supérieures en deux cycles : licence et master
- le recours aux crédits ECTS pour favoriser la reconnaissance des périodes d’études
- le développement de la mobilité
- la coopération en matière de garantie de la qualité
- le développement de la dimension européenne de l’enseignement supérieur
Le processus de Bologne a ainsi donné naissance au système LMD en France. Celui-ci permet d’uniformiser les cycles de formation universitaire et de faire reconnaître les diplômes entre chaque pays de l’Union européenne.
Une reconnaissance à l’échelle européenne grâce aux crédits ECTS
Avec le système licence-master-doctorat, le principe est clair : il y a un découpage des enseignements en semestres. Chaque semestre correspond à 30 crédits ECTS (European Credit Transfer System), un système européen de transfert et d’accumulation des crédits.
Ces derniers sont précisés dans les maquettes pédagogiques propres à chaque formation.
Les crédits ECTS concernent les formations universitaires — licences et masters généralistes — mais aussi les BUT (Bachelor universitaire de technologie) dispensés en IUT, les licences PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé) et les BTS, dispensés dans les lycées publics et privés. Ils sont calculés en fonction des différents enseignements et du nombre d’heures de travail : les cours magistraux (CM), les travaux dirigés (TD), les travaux pratiques (TP) et le travail personnel fourni par l’étudiant.
Pour chaque année validée à la suite des cours et des examens terminaux, de la première année de licence à la deuxième année de master, un étudiant obtient donc 60 crédits ECTS. À l’issue d’une licence, le diplôme confère 180 crédits ECTS. En master, on arrive à 300 crédits, puis 480 à l’issue du doctorat.
Tous les diplômes nationaux sont assujettis aux crédits ECTS, ce qui permet de les transférer d’un parcours à l’autre, lorsque les étudiants changent de cursus ou d’université, en France ou à l’étranger. Par exemple, lors d’un échange Erasmus, les crédits ECTS sont pris en compte dans la reconnaissance du diplôme.
La licence (bac+3) : le premier diplôme
La licence constitue le premier cycle universitaire, accessible après un baccalauréat. Elle se prépare en trois ans et débouche sur le diplôme national de licence qui octroie 180 crédits ECTS. En France, on recense une quarantaine de mentions de licences, qui peuvent se décliner en parcours. Pour candidater à une licence universitaire, il faut passer par la plateforme d’accès à l’enseignement supérieur, Parcoursup.
Droit, langues, santé, sciences humaines et sociales, économie, mathématiques… Les spécialités sont nombreuses. Elles peuvent être présentées sous plusieurs formes : des licences classiques « monodisciplinaires » comme la licence de psychologie, ou « pluridisciplinaires » comme la licence administration, économique et sociale (AES).
À l’université, la licence a une vocation théorique, contrairement à la licence professionnelle qui met l’accent sur la pratique. Celle-ci comprend 20 heures de cours minimum par semaine, réparties via les CM et les TD.
Par ailleurs, pour les bachelors des écoles privées, certaines sont dotés du grade de licence. Une reconnaissance essentielle pour assurer la qualité d’une formation et qui intègre le schéma licence-master-doctorat (LMD).
Le master (bac+5) : le second diplôme
Le master correspond au deuxième cycle universitaire, accessible après un diplôme de niveau bac+3 (licence, BUT, etc). Il est délivré par les universités françaises et dure deux ans, afin d’obtenir 300 crédits ECTS. L’accès est généralement très sélectif.
Deux masters existent dans une formation universitaire : le master professionnel et le master recherche. Le premier est à vocation professionnalisante et permet une insertion rapide dans le monde du travail grâce à des stages ou de l’alternance.
Le second — comme son nom l’indique — vise à faire de la recherche universitaire et permet de poursuivre en thèse et en doctorat. Néanmoins, il est possible de suivre des stages en master recherche tout en rédigeant son mémoire de recherche.
Pour les mastères des écoles supérieures privées, le grade de master est attribué à certaines formations. L’objectif est similaire à celui du grade de licence : permettre une grande reconnaissance du diplôme, en France et à l’international, et intégrer le schéma LMD. La plupart du temps, ce label est délivré par le ministère de l’Enseignement supérieur.
Le doctorat (bac+8) : le plus haut grade
La formation en doctorat est le plus haut grade universitaire. Il concerne les étudiants titulaires du diplôme national de master. Il octroie un niveau bac+8 et 480 crédits ECTS.
En doctorat, les étudiants préparent, en trois ans, une thèse dans le domaine souhaité. Ce cursus peut être dispensé à l’université ou dans une école doctorale. L’étudiant est accompagné par un directeur de thèse, chargé de suivre l’avancement de son travail et de l’épauler dans la rédaction de sa thèse.
Une fois la thèse complétée, l’étudiant passe sa soutenance devant un jury et il a par la suite plusieurs possibilités en tant que doctorant : devenir enseignant-chercheur dans une faculté ou en laboratoire ou exercer dans la recherche privée ou en entreprise.