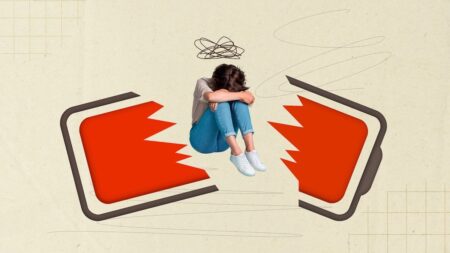La mue verte se confirme pour la communauté estudiantine. Selon une enquête menée par le Réseau Étudiant pour une Société Écologique et Solidaire (RESES), publié le 21 septembre dernier, 62 % des étudiants estiment que l’écologie est le sujet de société le plus important.
Cette étude quantitative s’inscrit dans des missions principales de l’asso. Baptisée Consultation nationale étudiante (CNE), cette étude quantitative se focalise sur le rapport des jeunes aux questions environnementales, leurs besoins et leurs attentes sur ces thématiques, notamment dans les établissements d’enseignement supérieur.
Les étudiants se sentent largement concernés par l’urgence climatique
Rejoindre le côté vert de la force. Si ce slogan a le vent en poupe lors des manifestations pour le climat, cela traduit aussi l’ambition du monde estudiantin sur le sujet. L’étude révèle ainsi que 7 étudiants sur 10 soutiennent la cause écologique.
L’urgence climatique, liée aux vagues de chaleurs successives, à la multiplication des catastrophes naturelles et les recommandations du GIEC qui en découlent ont alerté les plus jeunes populations. 16 % des sondés se déclarent militants et participent régulièrement à des actions et des mobilisations.
Néanmoins, les résultats montrent que la jeunesse est hétérogène et fragmentée sur la question : 60 % des personnes interrogées sont éco-actives et prêtes à agir, 36 % n’agissent pas, mais sont conscientes des enjeux, tandis que 4 % d’entre elles sont anti-écologistes, voire climatosceptiques.
D’autres éléments entrent aussi en compte pour les étudiants : le manque de temps et le manque d’argent. Dans ce contexte d’inflation et de difficultés financières visibles, 56 % admettent que la contrainte budgétaire ne leur permet pas de changer d’habitudes de consommation. 52 % des répondants parlent d’une contrainte de temps.
Écologie et politique : Pour 8 jeunes sur 10, l’État est l’acteur clé pour piloter la transition
Parmi les enjeux climatiques les plus préoccupants pour les étudiants, les sujets prioritaires sont : le réchauffement climatique (53 %), la destruction des écosystèmes (42 %), la perte de biodiversité et l’extinction des espèces (42 %) et, enfin, l’accès à l’eau (31 %).
S’ils se sentent majoritairement concernés par la transition écologique, ils ont aussi le sentiment que les différents acteurs politiques ont une « volonté limitée » pour faire face à la crise. Pour 80 % des étudiants, l’État est un acteur central de la transition écologique et 77 % ont l’impression que les intérêts des étudiants ne sont pas pris en compte dans les décisions politiques.
En 2021, le Conseil d’État a condamné deux fois l’Hexagone pour inaction climatique. Notre pays n’a pas rempli les objectifs fixés par l’Accord de Paris sur le climat et l’adoption, ainsi que sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. De quoi nourrir une certaine méfiance des étudiants, selon l’étude, à l’égard des institutions.
Mais le manque de confiance ne concerne pas uniquement l’État. 55 % des sondés indiquent que les grandes entreprises ont une responsabilité importante pour la transition écologique. Seulement 34 % déclarent faire confiance aux entreprises qui intègrent des dispositifs de RSE (Responsabilité sociétale des entreprises). À l’inverse, 1 étudiant sur 2 est circonspect envers les grandes entreprises quant à leurs engagements sociaux et environnementaux (33 % n’ont pas confiance, 17 % n’ont pas du tout confiance).
L’année dernière, une initiative étudiante avait marqué les esprits : des jeunes d’AgroParisTech étaient montés au créneau lors de leurs remises des diplômes. Ils ont dénoncé leur formation qui « participe aux ravages sociaux et écologiques ».
En corrélation avec cette étude, une autre enquête d’Harris Interactive de mars 2022 des jeunes sur les enjeux environnementaux dans la vie active montrait que 69 %« seraient prêts à changer d’emploi » pour un autre qui « soit écologiquement utile ».
Un besoin vital de se former aux enjeux écologiques dans l’enseignement supérieur
Des filières plus vertes, pour mieux éduquer, sensibiliser et former les étudiants dans la lutte contre le changement climatique. C’est ce que préconisent 76 % des sondés. Dans le détail, 7 répondants sur 10 souhaitent être davantage formés aux enjeux écologiques et 43 % des étudiants pensent que leur cursus ne les prépare pas assez à ces thématiques.
L’enquête révèle, par ailleurs, des disparités importantes dans les filières sur l’écologie et l’environnement dans l’enseignement supérieur. 85 % des sondés en agriculture ont des cours obligatoires sur les enjeux écologiques, contre 23 % de ceux en santé et 17 % en histoire ou en archéologie.
Comme le hasard fait bien les choses, la CNE 2023 fait le lien entre enseignements liés à l’écologie et militantisme. Les étudiants en agriculture, eaux et forêts sont deux fois plus engagés que l’ensemble de la communauté estudiantine (31 %). Puis, ils sont suivis par les jeunes inscrits en sciences humaines et sociales (22 %) et dans les cursus d’arts (16 %).
Enfin, les établissements d’enseignement supérieur n’ont pas les mêmes intégrations. À l’université, seul un étudiant sur dix considère que les enjeux écologiques sont inclus dans les cours, tandis que 54 % affirment ne suivre aucun cours qui traite sur le sujet.
Dans les grandes écoles, l’intégration est plus présente : 57 % des apprenants des écoles d’ingénieurs ont des enseignements au centre de leurs formations. Les Instituts d’études politiques (IEP) sont ceux qui proposent le plus d’enseignements sur ce sujet : 47%des étudiants ont plusieurs cours obligatoires, 34 % des options et 13 % expliquent que la thématique est au cœur de leur formation.