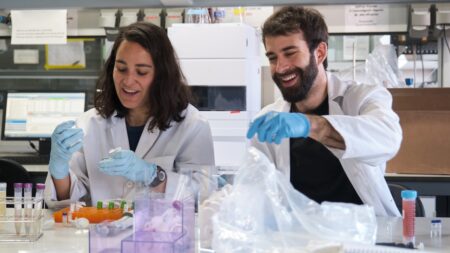Après plusieurs années passées à plancher sur un sujet pointu, à jongler entre bibliothèques, séminaires et nuits blanches pour finir leur thèses, les jeunes docteurs s'attendent souvent à voir leurs efforts récompensés.
Pourtant, une fois la soutenance passée, la réalité du marché de l’emploi peut refroidir les ardeurs. Le diplôme le plus élevé du système universitaire français ouvre-t-il vraiment les portes du monde du travail ? Éléments de réponse !
Doctorat : qui sont-ils ?
En France, le nombre de doctorants continue de reculer. À la rentrée 2023, on comptait environ 69 600 inscrits, soit une baisse d'un peu plus de 1 % par rapport à l'année précédente, et de plus de 11 % sur dix ans, selon les données du ministère de l'Enseignement supérieur. Les sciences humaines et sociales sont les plus touchées par ce recul : leur effectif a chuté d'environ un quart depuis 2012, tandis que les sciences du vivant progressent légèrement.
Le profil du doctorant varie beaucoup selon la discipline. L'âge moyen d'entrée en thèse tourne autour de 29 ans. En lettres, langues et sciences humaines, les doctorants sont souvent plus âgés, souvent parce qu'ils ont déjà une activité professionnelle. Dans les sciences exactes, ils commencent généralement plus tôt, à la sortie du master.
Le financement est un marqueur clé des inégalités entre disciplines. Près de quatre doctorants sur cinq bénéficient aujourd'hui d'un financement, mais cette moyenne cache de fortes disparités : quasiment tous les doctorants en sciences dures disposent d'un contrat ou d'une bourse, tandis qu'en sciences humaines et sociales, la moitié seulement est financée.
Le doctorat reste aussi un parcours international. Environ un doctorant sur trois vient de l'étranger, soit plus de 25 000 personnes. La majorité d'entre eux se concentre dans les disciplines scientifiques, qui offrent davantage de laboratoires d'accueil et de financements.
La répartition femmes-hommes, enfin, demeure contrastée. Si la parité est globalement atteinte, les femmes sont nettement majoritaires en lettres et sciences humaines, tandis qu'elles restent minoritaires dans les disciplines scientifiques.
Au total, les doctorants forment une population exigeante, diverse et souvent précaire, qui continue de faire vivre la recherche française malgré un manque de reconnaissance et une attractivité en baisse. Selon l'Alliance Athéna, cette érosion touche particulièrement les sciences humaines, où le nombre de nouveaux inscrits s'effondre depuis plus d'une décennie.
Plus de diplômés en doctorat, qu'en master (mais à nuancer)
D'après les derniers chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2023, près de neuf docteurs sur dix trouvent un emploi un an après leur diplôme.
Le doctorat, c'est clairement un diplôme rare en France. À peine 2 % des étudiants de l'enseignement supérieur vont jusqu'au bac+8, alors que le master reste beaucoup plus répandu. Mais rareté ne veut pas dire « job garanti ». Les masters affichent déjà un taux d'emploi solide, autour de 70 à 85 % à 18 mois après le diplôme, selon le ministère. Le doctorat, lui, joue plutôt la carte de la différenciation.
Dans les sciences exactes et certaines sciences du vivant, décrocher un poste stable et bien payé n'est pas impossible. Par contre, en sciences humaines et sociales, les débuts peuvent être compliqués : post-docs successifs, contrats courts, jobs à côté pour boucler les fins de mois… La reconnaissance du diplôme hors académique reste un vrai défi.
Le doctorat attire moins de monde que le master, et ce n'est pas forcément plus simple sur le marché du travail. C'est un investissement long, parfois précaire au départ, mais qui peut payer à long terme.
De la difficulté à trouver une stabilité
Dans les secteurs publics de la recherche et de l'enseignement, un docteur peut être en CDD durant 6 ans, contre 18 mois dans le privé seulement…
Une étude du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est intéressée au taux d'insertion des doctorants, trois ans après l'obtention de leur diplôme en 2014. Cette étude montre que le taux d'insertion de 85,3% dans le monde professionnel, un an après avoir décroché le doctorat.
Voici un tableau récapitulatif qui montre les situations d'emploi des doctorants à 12 mois (n+1) et 36 mois (n+3) qui suivent l'obtention du diplôme en 2020. Trois indicateurs ont été choisis par le MESRI et du SIES : le taux d'insertion, la stabilité du poste occupé et l'emploi en tant que cadre.
| Discipline | Taux d'insertion à n+3 (en %) | Taux d'insertion à n+1 | Emploi stables à n+3 | Emploi stables à n+1 | Emploi cadre à n+3 | Emploi cadre à n+1 |
| Ensemble | 90,8 | 85,3 | 65,6 | 52,2 | 92,0 | 92,2 |
| Sciences et leurs interactions | 91,9 | 86,9 | 68,6 | 51,7 | 94,3 | 95,8 |
| Mathématiques | 93,8 | 91,8 | 65 | 46,6 | 94,3 | 95,6 |
| Physique | 90 | 84,8 | 59,2 | 44,4 | 94,6 | 94,4 |
| Sciences de la terre et de l'univers, espace | 88,4 | 79,2 | 50,7 | 39,4 | 91 | 94,7 |
| Chimie et Sciences des matériaux | 89,4 | 81 | 62,9 | 45,4 | 93,7 | 94,6 |
| Sciences pour l'ingénieur | 93,1 | 89,1 | 77,9 | 57,7 | 97,2 | 97,5 |
| Sciences et TIC | 94,1 | 91 | 74,9 | 58,4 | 92,9 | 95,9 |
| Sciences du vivant | 90,1 | 82,8 | 49,4 | 37,2 | 94 | 92,4 |
| Biologie, médecine et santé | 91 | 84 | 46,9 | 35,5 | 94 | 92,4 |
| Sciences agronomiques et écologiques | 86,3 | 77,9 | 60,9 | 45,5 | 94,3 | 92,3 |
| Sciences humaines et humanités | 90,1 | 83,9 | 68,6 | 61,1 | 85,7 | 84,4 |
| Langues et littératures | 93,1 | 89,6 | 73,7 | 70,3 | 89,9 | 88,7 |
| Philosophie et arts | 88,2 | 78,7 | 55,9 | 55,5 | 86,2 | 81,7 |
| Histoire, géographie | 89,6 | 82,9 | 64,4 | 56,1 | 81,1 | 80 |
| Sciences humaines | 88 | 82,4 | 72,9 | 60,5 | 86,2 | 86,3 |
| Sciences de la société | 89,4 | 85,5 | 73,8 | 61,8 | 90,9 | 91,3 |
| Sciences économiques et de gestion | 92,8 | 91,4 | 74,6 | 59,4 | 91,5 | 93,4 |
| Sciences juridiques et politiques | 88,6 | 81,7 | 81,4 | 68,5 | 91,6 | 90,5 |
| Sciences sociales, sociologie, démographie | 85 | 81,8 | 58,7 | 56 | 88,3 | 88,6 |
94% des doctorants sont en emploi
Trois ans après la thèse, la majorité des docteurs a trouvé sa place : 94 % sont en emploi, 76 % ont un contrat stable et 94 % bossent en poste de cadre, toujours selon le ministère de l'Enseignement supérieur.
Mais derrière ces chiffres qui font rêver, il y a des différences selon les disciplines. Les docteurs en sciences exactes et appliquées cartonnent : 80 % en emploi stable et 97 % en cadre. En revanche, dans les sciences humaines et humanités, ça se complique : seulement 68,6 % ont un emploi stable, même si 85 % sont cadres.
Le doctorat reste un vrai sésame pour l'emploi, surtout dans les sciences dures, mais il faut garder en tête que certains parcours demandent un peu plus de patience et de débrouille, surtout en SHS.