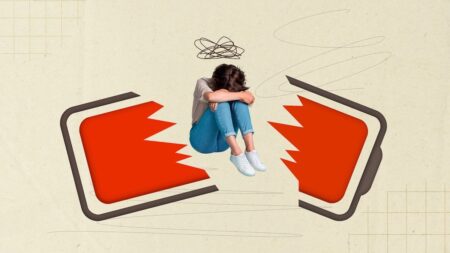Pensez-vous que les étudiants à l’université consomment plus d’alcool que ceux du secteur privé ou l’inverse ? En réalité, les effets néfastes de l’alcool ne dépendent pas seulement de la fréquence de consommation… Explication de ce phénomène.
Alcool à l’école et au travail : vers une consommation raisonnable
Un moment d’échange pour que « grandes écoles et entreprises se rapprochent pour faire en sorte que la consommation d’alcool soit mieux maîtrisée par les étudiants, et pour qu’une fois devenus cadres, ils continuent dans la même voie » : c’est ce que la Conférence des Grandes Écoles a cherché à atteindre en organisant l’événement. « L’objectif de cette conférence n’est pas de stigmatiser, mais bien d’informer et d’alerter sur les risques liés à l’alcool. »
Parmi les intervenants : Franck Gauthier, DRH d’Eiffage Construction, entreprise qui a bénéficié de l’intervention de Laurence Cottet, la présidente de « Janvier sobre », pour faire connaître aux salariés les dangers de l’alcool au travail et les moyens de prévention possibles.
L’entreprise de construction s’est en effet lancée dans une grande campagne de sensibilisation en 2019. « Notre volonté a été d’ouvrir les yeux sur l’ensemble des addictions et sensibiliser pour amener les équipes à se tourner vers une consommation raisonnable », relate le DRH. « On sait que quelqu’un qui est alcoolisé est un risque pour l’ensemble des personnes sur un chantier. On ne peut pas éviter l’alcool mondain, donc on a décidé d’expliquer à chaque direction régionale ce que cela signifie. On n’est pas médecins, notre volonté principale est la prévention », poursuit F.Gauthier.
Le docteur Olivier Phage et Tristan Hamonnière de la Fondation Santé des Étudiants de France (FSEF), tous deux responsables de « Peer Career », sont quant à eux intervenus pour aborder la question de la place de l’alcool dans la vie étudiante. Bien que la France soit un pays internationalement reconnu pour exceller dans l’art de « l’apéro », depuis peu, certains se laissent tenter par un mois sans alcool, après les festivités de fin d’année.
« L’alcool récurrent chez les étudiants n’est pas un problème. Le problème est le binge drinking. » FSEF
Le Dry January ou littéralement « janvier sec » en français, est un défi originaire du Royaume-Uni, qui consiste à ne pas boire d’alcool pendant 31 jours. Selon un sondage Yougov, les Millennials (Génération années 1990) et les 25-34 ans sont les plus sensibles à cette pratique. Ils seraient 10 % contre 6 % des 35-44 ans.
Quant à la Génération Z (15-25 ans), qui succède les millenials, la façon de boire est aussi différente que dangereuse pour la santé. Concrètement, la FSEF responsabilise les étudiants et donne une information claire sur l’impact des drogues, sur son développement dans le cerveau, et s’assure que l’info soit relayée. « L’alcool récurrent chez les étudiants n’est pas un problème, le problème est le binge drinking », alertent les représentants.
Le binge drinking chez les étudiants : une alcoolisation massive qui comporte des dangers
Selon les chiffres de Santé publique France et de la FSEF :
- 1 étudiant sur 4 présente une consommation d’alcool dangereuse
- 1 étudiant sur 5 rapporte une altération importante de sa qualité de vie en raison de l’alcool : difficultés de sommeil, dépenses importantes, trous de mémoire et baisse des performances académiques sont les difficultés les plus fréquemment invoquées
- chez les jeunes étudiants de 15 à 25 ans la consommation quotidienne d’alcool est de 4 % contre 2 % pour les autres jeunes adultes non étudiants
- chez les étudiants en écoles d’ingénieurs, en écoles de commerce, et en écoles de gestion, la prévalence d’API et d’ivresse est deux fois plus importante que chez les non-étudiants
- le binge drinking est plus fréquent dans les écoles qu’à l’université.
Le dry january tient bien !Passage tisane un peu intensif vers 19 h, mais ça tient !Beaucoup, beaucoup plus calme.Indéniablement, l’alcool accentue mes montagnes émotionnelles. pic.twitter.com/NXCu8GJya3
— Lechalote (@Lechalote12) January 18, 2022
Mais qu’est-ce que le binge drinking ?
On parle de binge drinking ou d’API (Alcoolisation Ponctuelle Importante) comme le fait de s’alcooliser dans un laps de temps très court, en recherchant l’ivresse. On peut également parler d’intoxication alcoolique aiguë ou d’alcoolisation massive. Il s’agit d’ingurgiter 3 ou 4 verres d’alcool en moins de 2 h.
Olivier Phan (pédopsychiatre addictologue) souligne que dans le binge drinking, la quantité d’alcool compte moins que la concentration : « Plus le taux d’alcool est élevé, plus la consommation est dangereuse. Les grandes fêtes et les petites fêtes font qu’il est répété. La vie étudiante est liée à l’alcool, car c’est une pratique qui est même proposée par des associations lors des salons, etc. »
Le fait que la consommation des jeunes étudiants est moins fréquente que chez les autres peut se comprendre par la préparation de leurs examens, d’après T.Hamonnière. « On a mené une enquête en 2021 sur 400 étudiants ingénieurs et il faut reconnaître que le milieu étudiant a ses spécificités par rapport au milieu familial. Le fait de quitter la maison et de se créer un groupe est aussi un des facteurs à prendre en compte. 29 % des consommations d’alcool sont régulières à l’université contre 55 % en école privée. On a observé que les étudiants en école montrent une prévalence deux fois plus importante à l’alcoolisation massive, que les étudiants d’universités. »
Depuis 2017, la FSEF a déployé plusieurs actions dans de grandes écoles et a créé le programme Peer Career, qui se veut préventif à plusieurs niveaux : sensibilisation, repérage et réduction des risques.
« Notre idée est que les étudiants aident d’autres étudiants. »
Responsabilisation des étudiants : la FSEF fait le pari de la prévention
Ainsi, la fondation cherche à éviter l’accident et faire alliance avec son public. « Notre idée principale est de transférer les compétences pour que ce soit les étudiants qui aident d’autres étudiants. On forme des petits groupes d’étudiants aux métiers de la santé et du bien être, qui vont effectuer des préventions par la suite et développer une culture de la prévention au fil des années. On espère ainsi modifier les modes de consommation ».
« On forme les jeunes à la gestion avec des outils comme le chill out ou “le coin chill” qui fonctionne vraiment bien. On les invite à se saisir de la fête et à organiser des espaces pour ceux qui ne se sentent pas bien », révèlent les responsables.
J’aime trop faire le dry January, j’y arrive grave bien
— luclecu (@lecfry) January 13, 2022
Alcool et santé mentale ne font pas bon ménage chez les jeunes scolarisés
On pense souvent aux dégâts physiques que peut engendrer l’alcool, mais quid des maux invisibles ? Dominique Monchablon, psychiatre et chef de service à la FSEF, dépeint la vie étudiante comme une période de vulnérabilité développementale particulièrement à risque, où consommer de l’alcool serait la norme.
« La psychiatrie est la seule spécialité ou plus on est malade, moins on consulte. Par conséquent, nous proposons un protocole d’immersion dans le système universitaire », rappelle la spécialiste. Elle signale également que la consommation excessive d’alcool peut entraîner des troubles psychologiques, dépressifs ou bipolaires.
Cette consommation est d’autant plus risquée qu’elle intervient dans une période de vulnérabilité développementale pendant laquelle les facteurs de risque sont nombreux : neuro génèse ; sensibilité particulière aux effets des substances ; rapport aux risques spécifiques ; pratique de consommation fortement valorisée par les pairs à cet âge… La FSEF indique d’ailleurs que la sensibilisation par les pairs est plus simple que d’accepter le soin par ces derniers. Les étudiants présentent des fragilités plus importantes que le reste du monde. Force est de constater qu’il existe une détresse psychologique croissante dans le monde estudiantin.
Selon la psychiatre, la Covid et donc l’isolement dû aux nombreux confinements ont eu beaucoup plus d’impact sur les jeunes étudiants que les jeunes actifs du même âge. En février 2021, le ministère de l’Enseignement supérieur a créé le « chèque psy » pour que les étudiants consultent gratuitement un psychologue, un psychothérapeute ou un psychiatre, sous certaines conditions. À noter que le dispositif est prolongé jusqu’au 31 août 2022 et donne droit à 8 séances « offertes ».
C’était la première fois que les Arts et Métiers réunissaient tout l’enseignement supérieur et le personnel de santé autour de cette thématique. La CGE et Janvier sobre ont d’ores et déjà prévu de se pencher de nouveau sur ce sujet crucial l’an prochain.