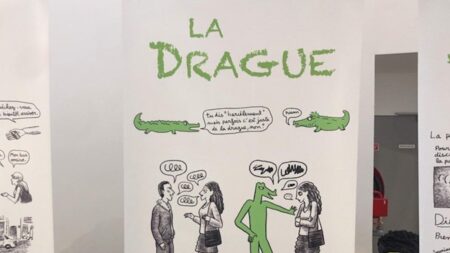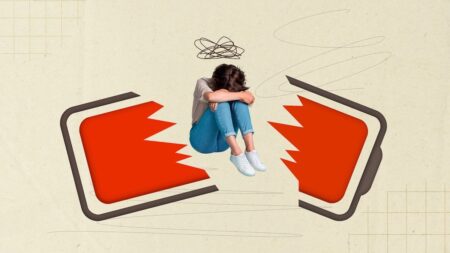Ce n’est plus un secret : depuis plusieurs années les enquêtes pour violences sexuelles ou sexistes s’enchainent dans les grandes écoles. À ce jour, 30 d’entre elles sont membres de la CPED, ainsi que 61 universités. La conférence se réunit au moins deux fois par an, afin d’échanger sur les pratiques des établissements et les moyens d’œuvrer à une politique d’égalité, de respect et de diversité.
Du côté alsacien, la mission égalité, parité, diversité de l’université de Strasbourg (ou unistra) a organisé deux journées de sensibilisation aux VSSH (Violences sexistes sexuelles et homophobes), en partenariat avec l’association SOS-France Victimes 67. Les objectifs sont d’informer, sensibiliser et mobiliser enseignants-chercheurs, personnels, ainsi qu’étudiants autour de deux dates clés : le 30 novembre et le 6 décembre 2022.
Ce mercredi 30 novembre, des stands composés de cinq ateliers sur les VSSH, mais aussi sur les violences conjugales, le droit à disposer de son corps, le harcèlement, le consentement, etc., ont été proposés dans le sous-sol de l’unistra. Face à eux, deux expositions. « Les crocodiles » de Thomas Mathieu et « Sans oui, c’est interdit », campagne du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

© Diplomeo
L’importance d’avoir un dispositif interne et externe
Sur place, les étudiants ont pu rencontrer trois juristes et une psychologue de l’association agréée par le ministère de la Justice et conventionnée avec l’université. Celle-ci propose un soutien juridique et psychologique externe d’aide aux victimes et tient une permanence un après-midi par semaine aux abords du campus. En interne, un dispositif de lutte contre les VSSH a été mis en place en 2018. Il s’agit d’une cellule d’écoute et d’accompagnement pour les victimes et témoins. Tenus à la discrétion et au secret professionnel, psychologues, assistantes sociales ou médecins s’engagent à répondre sous 48 h, à toute alerte reçue à l’adresse mail violences-sexistes@unistra.fr.
« Parfois, on vient nous voir pour des situations familiales ou de couple. En tant qu’université, on ne pouvait rien faire avant. », souligne Isabelle Kraus, vice-présidente égalité, parité, diversité de l’unistra. « Désormais, on oriente tout de suite vers l’association pour qu’il y ait une suite possible en dehors du cadre universitaire. » Néanmoins, l’établissement peut ouvrir une enquête interne et demander une commission disciplinaire, si nécessaire.
La vice-présidente précise que SOS-France Victimes 67 organise des formations à la fois à destination du personnel et des étudiants. Si les enseignants ont droit à dix sessions par an, les membres d’associations étudiantes sont formés sur deux jours à être des « trusted people ». Traduction anglaise de « personne de confiance ».
Toujours sur la base du volontariat, tous les élèves de licence ont un cours optionnel de lutte contre les discriminations, qui donne droit à trois crédits ECTS, nous apprend Isabelle Kraus. Pour elle, « afficher que l’université n’accepte pas ça et avoir un lieu où les gens peuvent en parler, c’est déjà énorme. »
Nous avons croisé Margot Fernbach, 21 ans, en service civique dans la mission égalité de l’université de Strasbourg. « Moi-même j’étais étudiante dans cette fac et je n’étais pas au courant de l’existence de ce dispositif, malgré l’intranet sur lequel on communique, qui compte seulement 150 abonnés. », déplore la jeune femme.
Faible participation, mais une grande opinion !
Deux étudiantes en 3e année de droit se sont installées au sous-sol où a eu lieu l’évènement et ont découvert, comme tous ceux que l’on a croisés, un peu par hasard, ce qui se tramait. Si la plupart se trouvaient là pour réviser ou étaient de passage, quelques-uns ont pris le temps de poser des questions et de participer aux ateliers.
« Je fais attention à la tenue que je porte quand on finit les cours à 20 h. » Lisa, 19 ans
Lisa, 19 ans, trouve que c’est une bonne chose de sensibiliser les étudiants, bien qu’elle ne se sente pas directement concernée. En revanche, elle nous a confié qu’une amie à elle en école de commerce a été victime d’une agression sexuelle lors d’une soirée étudiante. La jeune fille dont la famille est dans le sud de la France n’aurait ni porté plainte ni parlé de l’incident au personnel administratif, « faute de preuve ».
Deux étudiantes en master 1 de logique structurale et bio-informatique, dont une d’origine russe, n’étaient pas au courant non plus de cette journée de prévention. Assises à quelques mètres seulement des différents stands pour combler leurs trois heures de trous, elles nous avoueront toutefois que passer devant ces kakémonos leur a permis d’en discuter toutes les deux. Anna, 26 ans, qui a quitté Moscou il y a trois mois seulement, trouve que la France est en avance sur ces problématiques. « En Russie, cela dépend des régions. Dans les grandes villes, il y a généralement moins de problèmes que dans les endroits reculés, car les gens peuvent plus facilement obtenir de l’aide s’ils se font agresser ».
Niveau sécurité : elle se sent aussi bien dans l’Hexagone qu’à l’université de Moscou. Question des libertés, c’est une autre histoire. « En Russie, les homosexuels sont très discriminés, c’est interdit d’être homosexuel. Mes amis qui le sont ont quitté la Russie pour aller en Belgique, à Amsterdam ou encore en France. Ceux qui sont restés ne déclarent pas leur homosexualité. », reprend-elle. De même que d’autres élèves, sa camarade de classe Délia, 22 ans, nous a confessé qu’elle ne se sentait pas concernée, car pas la cible.
« On peut en parler entre nous, mais on n’est pas forcément concerné. En tous cas, on n’en parlerait pas forcément à nos parents », nous révèle Lisa. D’autant plus qu’une agression sexuelle peut être commise dans le cadre familial : « Quand j’avais 8 ans, un oncle a eu un geste déplacé envers moi, mais j’en ai parlé à mes parents que l’an dernier, car je ne mesurais pas la gravité. », nous dit Sabrina, 18 ans, en études juridiques. L’école devient alors un lieu refuge. « Je me sens en sécurité au sein de la fac. Moins dans les transports en commun. Je fais attention à la tenue que je porte quand on finit les cours à 20 h. », ajoute Lisa.
Debout devant les deux expositions, Marie Guinandi, juriste à l’association Sos France victime 67 s’est armé de questionnaires à trous, afin de définir ce qu’est une violence sexuelle et comment on la traite. Elle s’est préparée à répondre à toutes les questions concernant les infractions et leurs sanctions.

© Diplomeo
Que dit la loi dans tout ça ?
Au fait, qu’est-ce qu’une violence sexiste et sexuelle ? C’est un acte ou propos à connotation sexuelle. On parle alors d’outrage sexiste. Elle peut prendre une forme physique ou morale et avoir lieu dans n’importe quel environnement. À retenir : en droit pénal, une circonstance aggravante permet au juge d’alourdir, suivant son appréciation des faits, la peine légalement encourue par le prévenu ou l’accusé d’un crime ou délit. Or, il se trouve que la circonstance aggravante propre aux actes commis en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre est applicable à tous les textes de lois, ce qui est exceptionnel.
« C’est un message fort du législateur qui signifie qu’à partir du moment où le crime a été commis en raison de l’identité de genre, la peine est aggravée. Et on insiste bien là-dessus dans nos formations », affirme Colline Pichot, autre juriste de l’association et coordinatrice de l’aide aux victimes, chargée du partenariat avec l’université de Strasbourg.
« On informe l’étudiant qui vient vers nous de l’existence d’une cellule interne. Notre intervention se fait principalement au niveau de la procédure pénale. On va leur proposer de déposer plainte soit en les accompagnant physiquement, soit par courrier au procureur de la République. On peut également mettre en place un suivi psychologique. », ajoute-t-elle.
Selon ses dires, les cas de violences et agressions sexuelles seraient les plus récurrents. Elle affirme que la convention signée avec l’unistra a pour but de prendre en charge très rapidement les étudiants ou personnels, victimes de violences sexistes, sexuelles et homophobes. « On est en lien direct avec la cellule de l’université qui nous fait des orientations, mais les étudiants peuvent s’adresser directement à nous via une ligne dédiée », poursuit-elle, avant de reprendre : « Dans chaque école, nous formons des étudiants membres d’associations et du personnel pour recueillir la première parole. On leur explique le cadre juridique, si jamais ils sont témoins d’une scène de viol dans les toilettes d’une soirée, par exemple. »
Cette année uniquement, 160 étudiants de l’université strasbourgeoise (qui compte cinq sites) ont été formés par groupes de 15. La première partie de la formation est axée sur les définitions, la seconde sur les cas pratiques, puis une dernière partie psychologique sur la façon de prendre en charge les victimes, de trouver les mots justes, savoir ce qu’il faut éviter de dire, les former sur l’effet de la violence sur les victimes, sur le parcours des victimes, etc. Des attestations de formation leur sont délivrées à la fin. « On travaille avec d’autres écoles comme l’INSA, l’EM,L’ENSAS… et on forme les membres des BDE. », conclut la juriste.
Le 25 novembre dernier, c’était la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais dans la capitale alsacienne, ce jour a une tout autre signification.

© Diplomeo
Le 25 novembre : jour où tout a basculé pour les étudiants strasbourgeois
Tous les ans à cette date, l’université commémore la rafle du 25 novembre 1943. Pour rappel, à cette date historique de la Seconde Guerre mondiale, la France était encore sous occupation allemande. Des soldats nazis accompagnés de la Gestapo ont encerclé tous les bâtiments de l’université de Strasbourg, dont les locaux étaient situés au 34 avenue Carnot, à Clermont-Ferrand. Avec l’aide de l’étudiant Georges Mathieu, transfuge de la Résistance, une centaine d’étudiants catégorisés de juifs, résistants ou simples étrangers ont été arrêtés.
Mais alors, pourquoi l’université de Strasbourg n’était-elle pas à Strasbourg ? Eh bien ! parce que le 3 septembre 1939, à la suite de la déclaration de guerre, Strasbourg est déclarée zone militaire par l’État-major français. L’administration de l’Université est déplacée à Clermont-Ferrand, où s’installent également étudiants et professeurs. Malgré la création du Reichsuniversität Straßburg (université du Reich de Strasbourg créé suite à l’armistice), la majorité des Strasbourgeois ont préféré rester dans le Puy-de-Dôme.
C’est la raison pour laquelle la première des deux journées de sensibilisation aux VSSH que l’université de Strasbourg a organisée pour sensibiliser la communauté universitaire, s’est tenu le mercredi 27 novembre et non le 25. Pour la suite, des conférences sont prévues le 6 décembre 2022 de 17 h 30 à 19 h dans l’amphithéâtre Beretz.