Le bac est là. Plus vraiment le temps de réviser : l’heure est maintenant venue de gérer son stress afin de ne pas tout gâcher à cause de la panique et en faisant n’importe quoi !
Alors, avant toute chose, souffle un bon coup : Diplomeo a demandé à Annie Reithmann, directrice de l’IPECOM, spécialiste des méthodes d’apprentissage et prof de philo, ses meilleurs conseils aux lycéens de Terminale pour surmonter leur stress au bac, sésame indispensable pour faire son entrée dans l'enseignement supérieur.
Comment gérer son stress au bac ?
Est-ce qu’il existe une solution miracle au stress ou est-ce que gérer son stress révèle du cas par cas ?
Il n’y a pas de solution miracle, mais il y a des éléments qui peuvent diminuer le stress ou le combattre.
Avant le bac, il faut essayer de travailler d’une certaine manière. Par exemple, en travaillant en binôme pour qu’il n’y ait pas de silence, et qu’il n’y ait pas de laps de temps où on s’évade pour réfléchir sur les notes, sur le fait qu’on va avoir ou ne pas avoir son bac. Il faut parfois aussi se mobiliser en apprenant à haute voix : cela meuble le silence, où les petites voix du stress peuvent s’incruster. On peut régulièrement faire du sport. Par exemple, la natation, le jogging, et surtout faire régulièrement des exercices de respiration, tel que la sophrologie nous l’apprend. Sur internet, il y a énormément de petits exercices qu’on peut trouver comme par exemple faire le circuit de la respiration en passant par toutes les parties de notre corps. Enfin, il faut aussi visualiser le bac en se disant : « voilà ce qui va arriver pendant toute la semaine » afin de mieux anticiper les événements. En appréhendant un peu à l’avance les événements, on arrive mieux à se les approprier.
Et pendant le bac ?
Juste avant le bac, mais aussi au moment de l’épreuve, il faut s’hydrater régulièrement, faire ses exercices du corps ou de respiration : le stress fait souvent qu’on va très vite et qu’on ne lit pas le sujet, on le lit à moitié… Très souvent, on fait des hors sujets parce qu’on a lu deux mots à la place de cinq mots, donc il ne faut pas aller trop vite. Il faut essayer de lire le sujet à « voix haute intérieure » pour mieux le comprendre, tranquillement en prenant son temps et puis écrire sur une feuille toutes les idées qui nous viennent à l’esprit pour ne pas avoir peur de les perdre. Il faut se débarraser de cette inquiétude pour revenir sur le sujet et le relier pour bien comprendre les problèmes qui sont posés.
« On a souvent des ressources que l’on ne mesure pas et, au moment où le combat advient, qu’on mobilise de façon presque inconsciente »
Il faut toujours se répéter, avant ou pendant l’épreuve, que l’on doit se faire confiance puisque même si on ne sait pas, on peut toujours élaborer une réponse à partir d’un sujet, essayer de faire des liens, essayer de comprendre. On a souvent des ressources que l’on ne mesure pas et, au moment où le combat advient, qu’on mobilise de façon presque inconsciente : il faut donc se dire qu’on a confiance en soi et que quoiqu’il arrive nous arriverons à élaborer une partie au moins du sujet.
Donc le stress est lié à la confiance en soi ?
Exactement. Le stress c’est vraiment la confiance en soi. On peut être perfectionniste et avoir du stress, mais plus on travaille et plus le stress devient positif.
Le stress positif, ça existe ?
Oui, complètement. Quand un artiste ou un comédien entre sur scène, il a du stress qui mobilise les énergies. Il s’agit surtout de ça : canaliser et guider ses énergies. C’est pour ça qu’au fond, quand on révise, et si on révise bien, ce stress devient positif. Il est évident que quand on a fait beaucoup d’impasses et qu’on tombe dessus, c’est plus stressant que si on a révisé. Toutefois, très souvent pour le sujet du bac, la réponse est souvent induite, et on guide beaucoup dans les sujets, qu’il s’agisse des maths ou de la philo, d’histoire — géographie, d’économie.
« Il faut entrer dans la question, se l’approprier et se battre avec. »
Parfois, il y a des élèves qui ne travaillent pas énormément, mais qui le jour de l’épreuve, comme ils savent qu’ils n’ont pas énormément travaillé, se mobilisent énormément, se concentrent et arrivent au moins à avoir une note moyenne parce qu’ils ont pris au sérieux le sujet. Il ne faut pas faire comme si on savait faire une dissertation, comme si on allait répondre à la question : il faut entrer dans la question, se l’approprier et se battre avec, c’est-à-dire la prendre au sérieux. Si on pose une question à un élève et qu’on lui demande de réfléchir pendant quatre heures, ça veut dire que cette question mérite qu’on s’y attache pendant quatre heures. Essayez donc de voir pourquoi elle mérite qu’on s’y attèle pendant tant de temps.
Qu’est-ce que vous conseillez aux élèves qui n’arrivent pas à déconnecter après les épreuves du bac ?
D’une part, si on a une bonne note pendant toute l’année et qu’on sait qu’a priori on a des notes supérieures à 10, on peut « travailloter » de façon très « light » pour les oraux de rattrapage. Si on est très juste, il faut vraiment se remettre au travail pour les matières qu’on n’a pas travaillé.
Sinon il faut se déconnecter en allant au cinéma, en voyant des gens, en partant chez les grands-parents ou chez des amis pour être avec d’autres personnes et ne pas penser qu’au bac. De toute façon, il faut se dire qu’on n’a aucun pouvoir, et le stress c’est un peu ça, c’est quelque chose sur lequel on n’a pas de pouvoir. C’est là qu’intervient la confiance : il faut faire confiance au jugement qu’ont eu toute l’année les professeurs et se dire que si toute l’année on a eu cette note, on l’aura aussi au bac.
Souvent, on a quelques élèves au bac qui disent qu’ils ne stressent pas du tout. Qu’est-ce que vous en pensez ?
Ça peut arriver, bien sûr ! Parfois, certains élèves qui ont de très bonnes notes, qui ont été préparés pour des épreuves beaucoup plus dures, qui font des révisions pour Science Po ou d’autres préparations à des concours, ont appris à gérer leur travail. Certaines écoles apprennent aux élèves à être dans une ambiance de stress, que ce soit avec des DST (devoirs sur table) toutes les semaines, en faisant des examens blancs.
Moi je vois qu’à l’IPECOM on fait plusieurs examens blancs (DST, TD) pour justement apprendre aux élèves à mobiliser leur concentration et à gérer leur stress pendant deux heures, quatre heures, ou plus. C’est un vrai travail toute l’année qu’on doit entreprendre pour que, le jour J, on puisse tout donner. C’est aussi une élaboration du mental : plus on pousse les élèves à travailler dans une certaine difficulté, dans un temps très limité, plus ils réussissent ou apprennent à trouver les solutions à tels ou tels exercices. Ensuite, ils les réapprennent en se les réappropriant. Ce sont des éléments moteurs pour se rassurer et ne plus être inquiet le moment venu.
Le baccalauréat, c’est aussi l’une des premières épreuves pour savoir si on a confiance en soi ?
Oui, c’est l’une des premières épreuves, c’est un rituel de passage : c’est comme un ado qui passe à l’âge adulte, comme dans les compétitions sportives où l’on passe de minime à junior et de junior à senior. Et comme dans tout rituel de passage, il y a un enjeu. Dès qu’il y a un enjeu, c’est vrai qu’on peut avoir peur. D’ailleurs on le sait, les sportifs arrivent mieux à gérer les épreuves du bac que d’autres, parce qu’ils ont cette endurance, parce qu’ils ont cette concentration et cette mobilisation intellectuelle qui font qu’ils arrivent mieux à gérer leur stress.
Vous avez beaucoup parlé du travail en binôme et en groupe. Quels sont les atouts de ce type de travail pour gérer le stress ? Cela permet de relativiser ?
On relativise parce qu’à deux on se responsabilise, c’est-à-dire qu’on n’ose pas ne pas travailler, car on voit l’autre travailler. On ne veut pas le déranger donc on s’y met aussi. On peut aussi mieux gérer son temps, c’est-à-dire quand on a envie de s’arrêter à trois heures, on peut s’arrêter au bout de quatre ou cinq heures parce que l’autre n’a pas fini, que l’autre veut continuer. Donc c’est très stimulant. Parfois, quand on ne comprend pas, l’autre peut expliquer, il peut y avoir des échanges… Mais attention, expliquer, ce n’est pas perdre son temps : c’est une manière de reformuler et donc de mieux comprendre et mieux mémoriser. La répétition est souvent ce qui fait la force d’un travail, notamment pour l’oral : répéter plusieurs fois ce qu’on a appris, c’est acquérir des automatismes et donc être beaucoup plus efficace.
Qu’est-ce que vous pensez des médicaments et de l’homéopathie pour gérer son stress au bac ?
Moi je ne suis pas tout à fait pour. Il y a des choses très très très légères, mais au fond je crois que la meilleure manière de gérer son stress, c’est de travailler sur soi-même en se faisant confiance. Cette confiance en soi, c’est très jeune qu’on l’acquiert, et après on la fortifie tout au long de la vie. C’est souvent par les rapports avec les parents que ça se joue.
Vaincre le stress de ses parents pour le bac

Les parents sont souvent stressés quand leur enfant passe le bac : qu’est-ce que vous leur conseillez ?
Les parents aussi ont un rôle à jouer. Parfois, ils stressent tellement pour leur enfant qu’ils dégagent du stress, et induisent les enfants à se remettre en question, il y a une certaine méfiance qui s’installe : « Est-ce que tu vas réussir ? », « Est-ce que tu as suffisamment travaillé ? ». Il faut faire attention à ne pas induire le stress à ses enfants, même si on peut l’être personnellement parce qu’on ne maîtrise pas la situation. Il est vraiment important, quoi que fasse l’enfant, de lui montrer qu’on a confiance en lui parce que l’enfant a besoin de ce regard bienveillant et accompagnateur pour réussir, une sorte de reconnaissance qui peut passer par les professeurs, mais qui passe aussi par la famille.
Pour lui faire confiance, il faut lui proposer de l’aider à régler son organisation ou même son travail. Par exemple, faire des fiches, si on sait les faire, ou reprendre des livres pour l’aider à faire des fiches. C’est un peu comme un aide de camp qui facilite la vie de l’enfant. Ensuite, il ne faut pas stresser l’enfant, quelle que soit la situation. Si par exemple il ne travaille pas énormément : laissez-le dans ce « non-travail ». De toute façon, ce n’est pas parce qu’un parent va le forcer à travailler, que l’élève va travailler s’il ne veut pas. Il faut le motiver en le poussant à penser autrement, à lui parler de la vie après le bac, lui proposer aussi peut-être des « récompenses » après le bac, ou après une journée ou six heures de travail. On peut aller au cinéma, l’autoriser à jouer aux jeux vidéos pendant une heure, à voir ses amis… Donc il y a aussi un rapport de carotte — ou de bonbon — qu’on peut offrir.
« Donc je crois que les parents ont ce rôle-là à jouer, de dédramatiser la situation. »
Enfin, il faut lui montrer que finalement pour la dernière ligne droite, si on met un bon coup de travail on arrivera enfin à ses fins, et on sera débarrassé d’une première épreuve, pour ensuite faire ce qu’on a envie de faire. Le but est de le pousser à voir positivement le bac, non pas comme une sanction ou comme une fin de cycle, mais comme une ouverture et un début d’une nouvelle ère plus positive, parce qu’elle est un peu plus choisie. On peut choisir ses matières quand on va faire des études supérieures, donc on choisira plus aisément des choses qui nous plaisent plutôt que de faire des matières qui ne nous intéressent pas. Donc je crois que les parents ont ce rôle-là à jouer, de dédramatiser la situation en montrant que c’est une étape, et surtout, en ne comparant pas son enfant à d’autres situations familiales.
Par exemple, si un aîné a mieux réussi le bac ?
Voilà, il ne faut surtout pas faire ça. C’est très mauvais parce qu’ensuite, il y a de la compétition ou alors des réflexions du type « Lui il y arrive, moi je n’y arriverai pas. Puisque tu vois que je n’y arriverai pas, je ne le ferai pas. ». L’enfant s’inflige une sorte d’autopunition. Si on le considère comme un canard boiteux, il peut faire comme s’il était un canard boiteux et donc ne rien faire et être en échec. Ce sont des comportements qui arrivent quand on a un regard un peu négatif sur le travail de son enfant. C’est très stressant pour les enfants d’être comparé que ça soit à son ainé, à son frère ou à sa sœur plus jeunes. Dans les familles, les enfants ne sont pas du tout sous le même modèle : on fait parfois quatre enfants totalement différents. C’est justement la personnalité de chacun qui fait qu’à travers une éducation, on se retrouve on se crée une autonomie différente de celle des parents. Je crois qu’il faut accepter cette réalité-là. Parfois c’est aussi un chemin douloureux que font les parents !
Qu’est-ce que vous conseillez aux jeunes qui passent leur bac pour se distancier un peu de leurs aînés et comment ils peuvent gérer ça ?
Il y a la fois le fait de travailler en binôme avec des amis, et s’écarter du milieu familial pour aller, par exemple, chez les grands-parents ou dans des centres comme les couvents ou les abbayes qui reçoivent des jeunes pour travailler et avoir le calme, et s’écarter un peu de ce milieu qui peut être oppressant. S’il est oppressant, car parfois le milieu familial est très positif ! Mais si c’est le cas, il faut s’écarter de ce milieu-là pour être plus serein.
Et puis quand ça se passe bien, on peut se faire aider par les aînés, parce qu’ils sont passés par là et qu’ils doivent donner de bons conseils : utilisez les forces de l’aîné pour aller plus vite, pour être plus efficace. Il faut aussi se dire que chacun est différent : parfois ce n’est pas forcément parce qu’on y arrive plus vite qu’on est le meilleur gagnant. On peut y arriver par plusieurs chemins.
Le « stress pour tous »
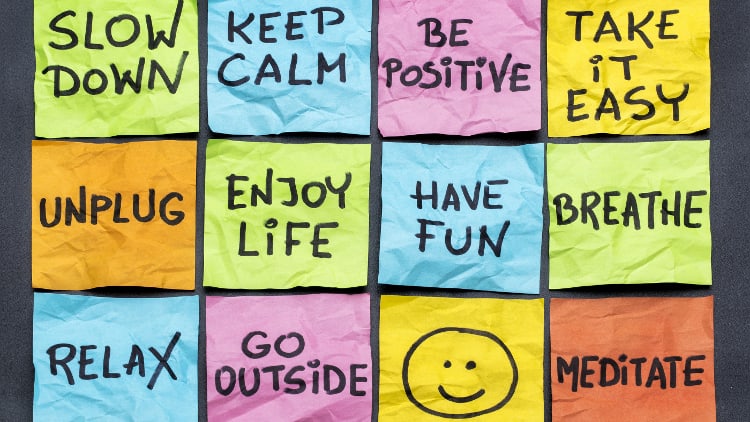
Est-ce que vous aussi vous stressez ? Si oui, appliquez-vous les conseils que vous donnez aux élèves ?
C’est vrai que ça m’arrive quand je dois faire des choses auxquelles je ne suis pas habituée. C’est aussi vrai que j’applique certains de ces conseils-là, et il y a quelque chose qui m’est vraiment utile : c’est de s’oublier soi-mêmepour se concentrer sur le contenu, c’est-à-dire ne pas écouter ses émotions, ne pas écouter sa voix intérieure et se rabattre sur la matière à faire, le discours à prononcer, la tâche à réaliser. En étant dans ce processus de réalisation et l’action de faire, on s’oublie soi-même, et on oublie les émotions qui sont présentes en nous pour les transformer positivement.






