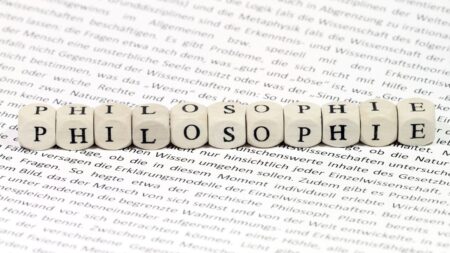Faut-il plutôt tout miser sur le rendu d’une copie blanche agrémentée d’une phrase percutante et sentencieuse, comme « Réussir son bac de philo ? C’est ça. » pour effectivement réussir l’épreuve de philo au bac ? Ou alors, la note finale dépend-elle de l’alignement des astres ou de l’humeur du lecteur. Ou encore, sont-ce des exemples décalés et des références à la pop culture qui assurent une note élevée ? Les légendes urbaines à propos de l’épreuve de philo vont bon train.
Pourtant, à l’instar de toutes les autres matières, la philosophie, ça se travaille ! Nul besoin de pratiquer le vaudou ou d’être un génie fou pour réussir cette épreuve tant redoutée. De la méthode, de l’entraînement, des révisions : c’est tout ce dont tu as besoin… Bon, et d’un peu de chance tout de même. Diplomeo fait le point !
Être attentif en cours
Pour beaucoup, les heures de philosophie sont l’occasion de faire un break dans la journée. Extirpe-toi de cette idée ! Résonner ainsi te fera perdre beaucoup de temps.
Ce n’est un secret pour personne, une grande partie du travail s’effectue en classe. Et il ne suffit pas d’être présent : ta présence doit être active. Écoute, réfléchis chaque fois que ton professeur t’y invite et si tu peux, participe.
De cette façon, tu assimileras naturellement et progressivement les connaissances. Tu gagnes donc un temps considérable sur tes révisions à la maison. Ce n’est pas à J-2 du bac que tu découvriras tous les repères. Tu sais, ces mots-clés qui reviennent sans cesse et qui fonctionnent souvent par pair. Par exemple : absolu et relatif, concret et abstrait, ou encore, convaincre et persuader. De plus, beaucoup de questions que tu peux te poser sont généralement traitées en salle de classe.
Faire des fiches de révision
Faire des fiches en philo est essentiel (Tiens, encore un mot repère !) ; d’autant plus si tu as une bonne mémoire visuelle. Elles peuvent t’aider à mettre de l’ordre dans tout l’amas de connaissances que tu as assimilées. Si tu comptes en faire, n’attends pas le dernier moment pour t’y mettre : fais-en tout au long de l’année.
La philo, ça s’apprend ! Ce n’est pas la fatalité, ni même la génétique qui fait de toi un bon ou mauvais élève dans cette matière. Comme R. Descartes pourrait te le dire, quand tu relis tes cours, c’est un sentiment de clarté qui doit émaner. Et pour cela, il faut être méthodique. Privilégie le format A4 ou A5. Un plus petit format oblige à écrire parfois très petit et très peu.
Le but n’est pas de réécrire l’intégralité de ton cours sur des feuilles individuelles, mais de le découper, puis de le restructurer. Tes fiches doivent être à la fois complètes dans leur contenu et directes dans la formulation. Listes à puces, flèches, code couleur : approprie-toi le cours.
Mais concrètement, qu’est-ce que ça donne ? Les fiches par notion sont plus exhaustives. Elles peuvent aborder des définitions, des auteurs, des œuvres, des citations. Par exemple, une fiche sur le thème du travail pourrait rassembler plusieurs des points suivants :
- La définition et l’étymologie du mot travail
- Les sous-thèmes associés, par exemple : la liberté, le loisir, le bonheur, l’affirmation de soi, l’aliénation, la nature, l’animalité, la société.
- Les références : auteurs, œuvres et citation, avec l’idée principale. Voici quelques exemples d’auteurs pertinents ici :
- K. Marx
- P. Lafargue
- F. Nietzsche
- H. Arendt
- F. Hegel
- E.Kant
- Aristote
- Des exemples de culture générale, comme :
- H. Ford et le travail à la chaîne
- Les Temps modernes, C. Chaplin, 1936
- L’organisation des abeilles dans les ruches
- etc.
Mémoriser quelques citations pertinentes
Les citations extraites d’ouvrages philosophiques ont le mérite de donner du poids à une dissertation. Elles peuvent aussi faciliter la mémorisation d’une idée. Face à un texte dense de plusieurs centaines de pages, une simple phrase peut contenir le cœur de la thèse d’un auteur. Plutôt pratique, non ?
Il n’est pas toujours facile de restituer aux auteurs leurs idées sans s’emmêler les pinceaux. B. Spinoza, Épicure, M. Heidegger… tu passes en revue beaucoup d’auteurs durant l’année.
Opte plutôt pour des citations courtes : tu les retiendras plus facilement. Par ailleurs, il faut aussi mettre un point d’honneur à sélectionner des passages que tu comprends ! N’hésite pas à piocher dans le vivier de citations qu’utilise ton prof. En parallèle, rien ne t’empêche de te concocter ta propre liste de citations, selon tes préférences. Le tout est qu’elles te parlent, que tu saches quand les utiliser correctement dans ton devoir et que tu sois capable de les expliquer.
Voici quelques exemples de citations, parmi tant d’autres, avec les notions qu’elles abordent :
| Citation | Auteur et ouvrage | Notions |
| « L’homme est la mesure de toute chose » | Platon citant Protagoras dans Thééthète (environ 370 av. J.-C) | La vérité, la raison, la nature |
| « Je pense, donc je suis » | R. Descartes dans Discours de la méthode (1637) | La vérité, la raison, la conscience et l’inconscient |
| « Le moi n’est pas maître dans sa propre maison » | S. Freud dans Une Difficulté de la psychanalyse (1917) | La conscience et l’inconscient |
| « L’expérience : c’est là le fondement de toutes nos connaissances, et c’est de là qu’elles tirent leur première origine » | J. Locke dans Essai sur l’entendement humain (1689) | La science |
| « En agissant sur la nature extérieure, à travers ce mouvement et en la transformant, il transforme aussi sa propre nature » | K. Marx dans Le Capital (1867) | Le travail, la nature et la technique |
| « Jamais nous n’avons été plus libres que sous l’occupation allemande » | J-P. Sartre dans Les Lettres françaises (1944) | Le devoir, la liberté |
| « Malheur à qui n’a plus rien à désirer ! Il perd pour ainsi dire tout ce qu’il possède. On jouit moins de ce qu’on obtient que de ce qu’on espère et l’on n’est heureux qu’avant d’être heureux » | J- J Rousseau dans Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761) | Le bonheur |
| « C’est la somme des intérêts particuliers qui constitue l’intérêt général » | J. Stuart Mill dans L’Utilitarisme (1871) | L’État |
| « Les limites de mon langage signifient les limites de mon univers » | L. Wittgenstein dans Tractatus Logico-philosophicus (1921) | Le langage |
| « Le présent du passé, c’est la mémoire ; le présent du présent, c’est l’intuition directe ; le présent de l’avenir, c’est l’attente » | Saint Augustin dans Confessions (397-401) | Le temps, la conscience et l’inconscient |
| « J’entends ici par antagonisme l’insociable sociabilité des hommes, c’est-à-dire leur penchant à entrer en société, penchant lié toutefois à une répulsion générale à le faire, qui menace constamment de dissoudre la société » | E. Kant dans Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique (1784) | L’État |
| « Une beauté naturelle est une belle chose ; la beauté artistique est une belle représentation d’une chose » | E. Kant dans Critique de la faculté de juger (1790) | L’art et la nature |
| « La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique » | B. Pascal dans Pensées (1670) | La justice |
| « C’est le cœur qui sent Dieu, et non la raison. Voilà ce que c’est que la foi » | B. Pascal dans Pensées (1670) | La religion |
Renforcer sa culture philosophique de manière ludique
Il existe une multitude de supports qui permettent d’étendre sa réflexion philosophique. Il y a les cours, mais pas seulement : films, séries, podcasts, chaînes YouTube spécialisées, livres, applications… Bonne nouvelle, il y en a pour tous les goûts.
Décortiquer des films et séries
En quoi le cinéma ou la littérature pourraient t’aider à obtenir un maximum de points à l’épreuve de philo au bac ? Comme dirait V. Jankélévitch, « Philosopher, c’est se comporter vis-à-vis de l’univers comme si rien n’allait de soi. » Pour renforcer ta culture philosophique, le mieux est de t’entraîner à te questionner sur tout, dont ton quotidien. Cela pourrit aussi contribuer à développer ton esprit critique. C’est ce que font très bien les fictions et les productions audiovisuelles. Elles abordent des thématiques plus familières et peut-être plus ancrées dans le réel.
Certains titres sont plus conseillés que d’autres. Beaucoup sont des dystopies, des thrillers psychologiques ou des drames. Par exemple, tu peux commencer par Matrix et The Truman Show pour la problématique de réalité et de l’illusion, Bienvenue à Gattaca pour son approche du déterminisme et de la liberté ou alors la série House of Cards pour le tableau qu’elle dresse de la politique.
Dans ta dissertation, tu peux aussi citer — avec parcimonie — ces titres pour appuyer tes propos. Les correcteurs verront ça d’un bon œil. Attention tout de même à ne pas faire l’impasse sur les références philosophiques académiques !
Suivre l’actualité
Suivre l’actualité est aussi un excellent moyen de s’interroger sur les dix-sept notions au programme de philosophie. En outre, un évènement de l’actualité peut t’inspirer pour bâtir une accroche de dissertation — si c’est l’épreuve que tu choisis le jour J. Cela montre au correcteur ta capacité de mettre en écho ce que tu as vu en cours avec le monde d’aujourd’hui. C’est un atout de poids.
Pour garder un œil sur les dernières nouvelles, encore une fois, les supports sont variés : journaux papiers et en ligne, les réseaux sociaux, la télévision… À toi de choisir !
Réviser autrement qu’avec ses notes
Réviser les cours de philo, ça peut aussi se faire en s’amusant. Des applis sont pensées pour faire des moments de révision, des moments ludiques. Tu fais partie des accros à leur smartphone ? Sache que le temps passé dessus peut se transformer en temps studieux plutôt qu’en temps perdu !
La-Philosophie.com et son application ou encore Philohack, par exemple, proposent des fiches de révision, des récapitulatifs d’auteurs, des citations et des quiz. Certaines applis se présentent également comme des jeux éducatifs. C’est le cas par exemple de Philodéfi.
Plutôt branché podcast et vidéos ? Alors, le site de Radiofrance peut être fait pour toi. Des chaînes YouTube favorisent également l’apprentissage philosophique, à l’instar de La Philo en petits morceaux, Les Clés de la philo ou encore, Coup de Phil.
Maîtriser la méthode de l’exercice
Trois parts en l’homme dans la théorie de l’inconscient chez S. Freud. Trois niveaux de connaissance limitée dans le monde sensible de l’Allégorie de la caverne. Et aussi, trois sujets parmi lesquels choisir au bac de philo : deux sujets de dissertation et un commentaire de texte. Il vaut donc mieux connaître les exigences de chacun de ces exercices.
La dissertation
La dissertation est l’exercice phare de la discipline. En maîtriser les codes est donc indispensable. Besoin d’une brève piqûre de rappel ?
Un débat d’idées, une argumentation organisée, une réflexion bien ficelée… Mais surtout pas un catalogue de théories d’auteurs. Il ne s’agit pas de réciter son cours, mais bien de traiter plusieurs problèmes posés par un sujet précis.
Pour ce faire, il est préférable de bien analyser la formulation du sujet et la définition des mots-clés et verbes de l’énoncé. Souvent, cette analyse débouche sur l’identification d’un paradoxe ou d’un double sens. À partir de là, tu peux mettre la lumière sur plusieurs questions que pose l’énoncé. Ta problématique doit englober toutes ces questions. Au cours de ce travail d’analyse, tu identifies également les notions du programme que convoque le sujet.
Voici quelques pistes d’analyse de l’énoncé du bac général de philo 2022, « Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? » :
Définis les termes du sujet :
| Définition des termes | |
| Les pratiques artistiques |
En tout cas, ici, on ne parle pas du public, mais bien de l’individu qui fait de l’art. |
| Artistiques/art | Il vaut mieux penser à toutes les formes d’art et pas seulement aux arts plastiques. |
| Transformer | C’est l’action de faire changer quelque chose par rapport à son état initial. Ce changement peut être jugé comme étant positif ou négatif. |
| Le monde | On pense volontiers à :
|
Identifie un paradoxe. Par exemple : Une production artistique découle de l’esprit d’un artiste, donc d’une individualité. On peut donc dire que l’art appartient au domaine de l’imaginaire. Pourtant, « transformer le monde » semble être une action concrète avec des résultats concrets, avec une dimension universelle.
Ensuite, mets en lumière des problèmes :
| Problèmes | |
| L’artiste, son intention et son rôle dans la société | L’artiste a-t-il vraiment l’intention d’avoir un impact sur le monde au moment où il crée ? Ne s’agit-il pas plutôt d’un processus récréatif et personnel ? N’est-ce pas plutôt le rôle de la politique d’influencer la société et la vie des hommes ? |
| L’artiste, sa représentation du monde et son esprit | Quand il crée et produit de l’art, l’artiste puise dans son monde intérieur et l’exprime. Ils donnent à voir un peu de sa représentation du monde et de ses émotions. Il transforme ce monde intérieur brut en lui pour en faire quelque chose : de l’art. Est-ce que ça a le pouvoir d’avoir un impact réel sur le monde extérieur et la société ? |
| L’art et la politique | Si oui, comment et pourquoi les pratiques artistiques parviennent-elles à influencer la société ? Est-ce une bonne chose ? Une mauvaise chose ? Le font-elles en contradiction avec la politique ou peuvent-elles s’allier ? |
| L’artiste et son public, l’individualité et l’universel | Le monde intérieur de l’un ne peut-il pas ressembler à celui d’un autre ? L’autre ne peut-il pas trouver qu’un peu du monde intérieur de l’un fait écho à son monde intérieur ? En d’autres termes, les hommes n’ont-ils rien en commun ? Ne partagent-ils pas des expériences et une représentation du monde communes ? |
| L’art et la représentation | L’art ne donne-t-il pas à voir le monde autrement ? Qu’apporte en plus la représentation du monde par l’art ? Peut-être l’art représente-t-il le monde tel qu’il est réellement, avec plus de fidélité ? À quel point l’art s’inscrit-il dans le réel et montre le réel ? |
Après cela, les notions et sous thèmes liés t’apparaîtront plus facilement : le travail, la technique, la nature, la conscience et l’inconscient.
Une fois ce travail effectué, te voilà fin prêt à te lancer dans la rédaction de la dissertation. Elle doit comporter plusieurs parties :
- L’introduction, qui comporte elle-même :
- une accroche
- l’énoncé tel qu’il est formulé
- une problématique
- un plan
- Le développement en trois parties :
- thèse
- antithèse
- dépassement
- La conclusion
💡Attention : la dernière partie de la dissertation n’est pas une synthèse à proprement parler ! Il ne s’agit pas de répéter un peu de ce que tu as dit dans la thèse et un peu de ce que tu as dit dans l’antithèse. Ce n’est pas une conclusion. Cette partie doit apporter réellement une nouvelle perspective au débat. Tu as choisi la spécialité mathématiques ? Alors cet exemple devrait te parler : pour schématiser, si la thèse est A et l’antithèse B, la troisième partie ne doit pas être AB, ni D, mais bien C, un nouvel élément cohérent.
Un paragraphe, une idée. On te rabâche cette phrase depuis le début du lycée, et à raison ! Bien que complexe, ta réflexion doit être claire et agréable à lire pour l’examinateur. C’est aussi comme ça que tu parviendras à le captiver.
Chacune de tes parties doit contenir une idée directrice. Il est préférable de se limiter à un auteur par paragraphe. Cette référence à un auteur et à sa thèse peut être complétée par une illustration. Celle-ci peut être tirée d’une œuvre littéraire, d’un film, d’un tableau… N’hésite pas à puiser dans les œuvres complémentaires mentionnées par ton prof : l’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde dans le cadre du cours sur la conscience et l’inconscient ou encore l’installation artistique One and three chairs (Une et trois chaises) pour le langage : sers-toi !
Le commentaire de texte
Tu n’es pas à l’abri d’avoir un coup de cœur pour le texte sélectionné ! Imagine : tu as particulièrement bien étudié J-J. Rousseau toute l’année. Arrive le jour J et devant tes yeux ébahis : un extrait du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (petit tips : DOFIH). Ça serait dommage de passer à côté parce que tu as condamné d’office cet exercice ou que tu le tiens pour acquis. Il a ses exigences !
Le texte, rien que le texte. C’est la règle d’or. Il ne s’agit pas de faire une dissertation sur le thème du texte sélectionné. Tu dois absolument décortiquer le texte dans son intégralité et l’expliquer. Tu as déjà tenté l’exercice en cours d’année sans grand succès ? C’est normal ! En revanche, à la fin de l’année, te voilà avec assez de thèses sur différents thèmes à ta disposition pour aborder l’exercice avec confiance. Tu ne connais pas l’auteur ? Ce n’est en aucun cas un obstacle !
Tu n’inventes rien, tu identifies. Au moment d’aborder le texte, il faut en dégager trois éléments essentiels :
- le thème
- la thèse
- la problématique
Le commentaire doit se composer de plusieurs parties :
- L’introduction, laquelle comporte :
- la présentation générale de l’œuvre et son contexte d’écriture
- la présentation de l’extrait et de son thème
- la problématique de l’extrait
- la thèse formulée dans l’extrait
- le plan : en général, il est linéaire. Il suit le découpage naturel de l’extrait.
- Le développement : il peut comporter deux ou trois parties.
- La conclusion. En principe, elle contient :
- la réponse de l’extrait à la problématique
- une critique de la nature de cette réponse (force ou faiblesse)
Lorsque tu annonces ton plan, veilles à bien citer les lignes qui concernent chaque partie. Ton commentaire doit rendre compte de la progression de la réflexion de l’auteur au cours de l’extrait.
Dans le développement, ne cède pas à la périphrase. Il faut essayer d’expliquer ce qui amène l’auteur à ses réflexions et ce qui se cache derrière celles-ci. Bien sûr, tu peux accoler des lignes ou des expressions de l’extrait à ton explication pour bien guider le lecteur. Chacune de tes parties doit commencer par une phrase qui présente son idée directrice.
Mais par où commencer ? Lis plusieurs fois le texte. Procède d’abord à une première lecture de découverte. Puis, au fur et à mesure des autres lectures, stabilo et stylo en main, identifie les éléments phares tels que le thème, la thèse et la problématique. Délimite les étapes du texte et retiens la progression de la réflexion de l’auteur.
Et surtout, note bien les mots-clés. Ce sont ces termes-là et leur utilisation dans le texte que tu dois passer du temps à expliquer. Ça peut être les notions et les concepts comme le désir, le plaisir ou le bonheur, les verbes comme sentir, diminuer ou rester, les noms communs comme sentiments, peine ou disproportion et enfin les adjectifs comme inséparable, pénible ou vrai : passe tout au crible !
S’entraîner avec des annales
Si c’est en forgeant que l’on devient forgeron, c’est bien en consultant des annales qu’on multiplie ses chances de produire des copies géniales. La philo, ce n’est pas inné. Certains peuvent avoir une plus grande appétence que d’autres dans cette matière. Toutefois, une fois la méthodologie de la dissertation et du commentaire de texte bien assimilée, tu disposes d’un bon coup d’avance.
Les sujets des années précédentes et leurs corrigés te donnent des indices sur les attendus des correcteurs, les thématiques qui reviennent souvent ou celles qui ne sont pas tombées depuis longtemps. Pour t’entraîner, ne rédige pas la dissertation ou le commentaire en entier. Produis plutôt un plan détaillé puis vérifie le tout avec la correction. Garde en tête qu’en philo, il n’y a pas qu’un seul plan qui est valable. À force d’entraînement, tu adoptes les bons réflexes.
Quelques conseils pour le jour J
Le jour J approche à grands pas et tu as suivi tous ces sages conseils ? Malgré tout, le stress ne te lâche pas ? Voici quelques conseils.
Mets-toi en confiance
C’est facile à dire, mais essaye de penser positif et de te plonger dans un « bon mood ». Écoute « I gotta feeling » du groupe Black Eyed Peas si le cœur t’en dit, ou tout autre titre qui te met de bonne humeur. Tu as des chaussettes porte-bonheur ? Mets-les ! Tout est bon pour se sentir plus à l’aise lors de l’épreuve.
Attention cependant à ne pas te montrer trop sûr de toi, notamment dans ta manière d’écrire : en philosophie, plus tu montres que « tu sais que tu ne sais rien » — comme dirait Socrate — plus ta copie aura des chances d’être bien accueillie par le correcteur. L’humilité intellectuelle est de mise, surtout si tu choisis la dissertation.
Gérer son temps intelligemment
Avant toute chose, note bien à quelle heure se déroule le bac philo : l’essentiel est d’arriver à l’heure voire à l’avance. Rien de pire que d’être en retard quand on est déjà stressé.
Une fois arrivé et prêt à attaquer le sujet, prends ton temps, tout en gardant un œil attentif à ta montre. Compte environ 15 minutes pour le choix du sujet. Ce moment est déterminant. Se jeter sur une question, car on connaît par cœur le cours qui y est associé est l’une des pires erreurs à faire ! Ensuite, analyse longuement l’énoncé sélectionné, relève les mots-clés et définis-les au brouillon.
Le rythme de rédaction varie selon les élèves, il est donc important de bien se connaître. Le principal est de ne pas se retrouver à devoir bâcler l’introduction, la dernière partie du développement ou la conclusion par manque de temps.
Bien structurer sa copie
Une bonne gestion du temps et un brouillon bien travaillé sont les clés d’une copie bien rédigée. Ta copie doit être claire et lisible. Pour ce faire, ne sois pas avare en mots de liaison, réfléchis aux transitions entre tes parties, inclus des citations de façon pertinente et surtout, aère ta copie !
Passe à la ligne entre les paragraphes, effectue un retrait de deux ou plusieurs carreaux pour commencer une nouvelle partie. Saute des lignes dans le corps de texte, entre l’introduction et le développement, par exemple.
Consacrer du temps à la relecture
Personne n’est à l’abri de fautes d’orthographe. Cependant, il serait quand même dommage de perdre des points pour une erreur que tu aurais pu facilement éviter ou corriger !
Se replonger dans sa copie, après avoir longuement planché dessus demande du courage. Pourtant, J-J. Rousseau met en garde : « Il n’y a pas de bonheur sans courage. » (Emile ou De l’éducation). Tu veux mettre toutes les chances de ton côté ? Une fois la totalité de ta copie rédigée, prends du temps pour la relire en entier.
Prête attention aux fautes d’orthographe, aux accords, au pluriel, à la ponctuation et aux conjugaisons. Tu as oublié un bout de phrase ? N’hésite pas à ajouter une annotation et un astérisque qui renverra ton lecteur en fin de page ou de copie par exemple, là où il pourra lire la suite de la phrase. Pour éviter de tels oublis, il est préférable de te relire tout au long de ta rédaction : après chaque paragraphe ou partie, par exemple. En revanche, même dans ce cas là, il reste conseillé de procéder à une relecture globale en fin de rédaction.
Te voilà rassuré ou au contraire, toujours pris par le stress ? Pas de panique, il y a du bon dans le doute. Pense au doute cartésien : le doute fait agir et rapproche de la sagesse. À tes fiches !