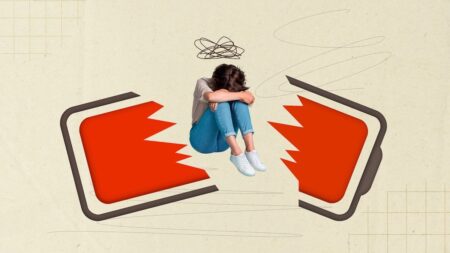Les incertitudes budgétaires planent sur les universités françaises. Tandis que plus de 60 établissements de l’Hexagone risquent de terminer l’année 2025 dans le rouge, le président de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), Jean-Luc Dubois-Randé, dénonce un financement économique archaïque dans le public, tout en faisant part de sa plus grande inquiétude quant à ce phénomène.
Dans une interview accordée à Diplomeo, le doyen préconise plusieurs pistes pour sortir la tête de l’eau, au moment où l’UPEC se tire à peu près d’affaire quant à son propre déficit budgétaire. Jean-Luc Dubois-Randé appelle à plus de moyens financiers pour l’enseignement supérieur et la recherche pour que les universités développent davantage leur autonomie et leurs formations en apprentissage. La lutte contre la précarité étudiante doit, selon lui, se poursuivre afin de garantir à toutes et tous de bonnes conditions d’études.
En 2024, vous évoquiez un déficit de 7 millions d’euros pour l’UPEC, notamment lié à l’augmentation du nombre d’étudiants. Quelle est votre situation aujourd’hui ?
Le contexte du déficit, c’est que nous avons accueilli plus de 10 000 étudiants en cinq ans, ce qui représente une augmentation considérable. Cette pression démographique sur notre territoire ne va pas s’arrêter, bien au contraire.
On parle souvent d’une « bulle » démographique qui atteindrait son pic vers 2030, mais nous constatons que l’augmentation se poursuit. Cela s’explique par deux grandes raisons. La dynamique du Grand Paris attire de plus en plus de familles et de classes moyennes dans notre secteur. L’attractivité croissante de notre université, mais aussi, liée à notre offre en apprentissage, notre taux d’employabilité élevé et notre excellence en recherche sont aussi plébiscités.
En termes budgétaires, nous sommes financés à hauteur de 6 500 euros par étudiant, alors que d’autres universités similaires reçoivent 7 000 euros. Si l’on compare avec les établissements les mieux dotés, comme Paris-Saclay, qui reçoivent 10 000 à 12 000 euros par étudiant, l’écart est encore plus frappant. Cet écart budgétaire crée donc un trou financier pour notre université. Nos capacités d’accueil ont été poussées par l’État et le rectorat, mais sans que les financements suivent.
Bien sûr, nous sommes un service public, et nous ne pouvons pas refuser les étudiants. D’autant que nous avons la volonté forte d’accueillir la diversité du territoire, car nous considérons que l’université est un lieu d’émancipation et de réussite. Nous acceptons donc ces étudiants avec enthousiasme, mais nous regrettons que les moyens ne soient pas au rendez-vous.
L’année dernière, cela nous a conduits à voter un budget rectificatif à -9 millions d’euros et un budget initial à -4 millions d’euros cette année. Nous avons mis en place un plan de retour à l’équilibre et, sans être devins, nous pensons pouvoir atteindre cet équilibre financier dès 2025. Cela est rendu possible grâce à un énorme travail de pilotage des dépenses, accompagné par l’État dans le cadre des contrats d’objectifs, de moyens et de performance. Nous avons aussi renforcé nos ressources propres, en particulier grâce à l’apprentissage, qui est l’un de nos points forts.
Vous dites que vous avez beaucoup misé sur l’apprentissage au sein de votre établissement. Est-ce que les récentes décisions du gouvernement sur l’alternance et sur les coupes budgétaires vous inquiètent ?
Nous sommes plutôt rassurés sur ce point. Contrairement aux entreprises, nous n’avons pas de reste à charge à supporter au niveau de l’université. L’apprentissage ne nous pénalise donc pas financièrement, sauf si les règles venaient à changer dans les mois ou les années à venir.
« L’apprentissage est un dispositif qui offre une opportunité à un public défavorisé, qui, sans cela, ne poursuivrait pas forcément ses études »
Nous avons aussi été attentifs aux annonces concernant le master en apprentissage, et nous constatons qu’elles semblent aujourd’hui s’éloigner. Pourquoi est-ce un enjeu majeur pour nous ? Parce que ce mode de scolarité crée de l’emploi et améliore la réussite des étudiants, on ne cesse de le montrer et de le démontrer. L’apprentissage est un dispositif qui offre une opportunité à un public défavorisé, qui, sans cela, ne poursuivrait pas forcément ses études, ou d’accéder à une formation et à un métier qualifié.
Vous parlez d’un retour à l’équilibre en 2025, mais y a-t-il encore des incertitudes ?
Oui, bien sûr. Chaque fois que nous pensons sortir la tête de l’eau, de nouvelles charges imprévues sont imposées par l’État. Un exemple très concret est le « casse-pension », c’est-à-dire l’augmentation des cotisations pour les retraites des fonctionnaires. Pour notre université, cela représente 3,2 millions d’euros à financer en plus.
Pour compenser cela, nous sommes obligés de réaliser 3,2 millions d’économies supplémentaires. Même si nous atteignons l’équilibre budgétaire, c’est donc au prix de restrictions sur notre fonctionnement et nos investissements.
Nous aurons un budget équilibré en 2025, mais cela signifie moins d’investissements dans les bâtiments, les infrastructures et la recherche.
D’ailleurs, en ce qui concerne la recherche, nous dénonçons depuis des années un sous-financement chronique. Aujourd’hui, la France consacre 2,2 % de son PIB à la recherche, alors que d’autres pays européens atteignent 3 %. C’est nettement insuffisant, et nous voyons que nous décrochons sur le plan international.
Nous avons l’impression d’un dialogue de sourds avec les décideurs politiques, qui ne semblent pas comprendre ce qu’est la recherche et l’innovation et ses enjeux à long terme. Si, en 2025, l’État ne compense pas le « casse-pension » et les autres mesures qui nous impactent, nous risquons de tomber dans un effet de yo-yo budgétaire, avec des périodes de déficit qui reviendront régulièrement.
Au niveau national, on parle de 60 universités qui risquent d’être en déficit cette année. Êtes-vous inquiet pour l’avenir de l’enseignement supérieur public en France ?
Oui, c’est une préoccupation majeure et dont on discute régulièrement avec France Universités. Le problème, c’est que nous n’avons pas de modèle économique clair pour les universités. Les financements publics sont attribués de manière archaïque, sans logique uniforme. Certaines universités reçoivent 5 000 euros par étudiant, d’autres
12 000 euros : il n’y a aucune cohérence.
Par exemple, les universités très axées sur les sciences humaines et sociales ont plus de difficultés, car elles n’ont pas les mêmes sources de financement.
« Aujourd’hui, on a le sentiment que l’État ne soutient pas suffisamment les universités. C’est un choix politique, mais il envoie un signal inquiétant sur l’avenir de l’université française »
C’est une grande source d’inquiétude, non seulement pour moi, mais aussi pour tous mes collègues de France Universités. Aujourd’hui, on a le sentiment que l’État — comme l’a souligné notre collègue de l’université de Strasbourg — ne soutient pas suffisamment les universités. C’est un choix politique, mais il envoie un signal inquiétant sur l’avenir de l’université française.
L’une des missions essentielles de l’université, c’est justement d’ouvrir ses portes à des étudiants qui, sans cela, ne s’y autoriseraient pas. Or, la précarité étudiante est une réalité. Chez nous, 25 % des étudiants sont en situation de grande précarité et 70 % doivent travailler pour financer leurs études (sans compter ceux qui sont en alternance). Ces chiffres en disent long sur les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien, et ils ne sont pas les seuls dans cette situation.
L’accès au logement étudiant est aussi un enjeu majeur, surtout en région parisienne. Beaucoup d’étudiants n’ont d’autre choix que de rester chez leurs parents. L’université doit être un levier d’émancipation sociale, mais pour cela, il faut des moyens.
Le gouvernement a annoncé une coupe budgétaire de 630 millions d’euros dans le cadre du projet de loi de finances 2025. Comment avez-vous réagi à cette annonce et comment prévoyez-vous de vous adapter à cette baisse de budget ?
Malheureusement, ce n’est pas une surprise. À un moment, nous espérions un milliard d’euros supplémentaires dans le cadre des projets de la Loi de Programmation pour la Recherche (LPR), mais ce financement a été revu à la baisse. Le problème, c’est que ces coupes sont diffuses : elles impactent plusieurs secteurs en même temps, rendant l’adaptation extrêmement difficile. À un moment donné, l’adaptation n’est tout simplement plus possible.
Bien sûr, nous pouvons toujours essayer de réaliser des économies, mais cela signifie quoi en pratique ? Plusieurs formations seront arrêtées faute de moyens. Nous sommes très inquiets concernant la formation des professeurs des écoles et du secondaire (le master MEEF). Aujourd’hui, certaines de ces formations accueillent trop peu d’étudiants, ce qui entraîne des réflexions sur leur mutualisation à l’échelle de l’Île-de-France.
D’autres formations sont également en danger, non pas parce qu’elles sont inutiles, mais parce qu’elles attirent moins d’étudiants. Or, le nombre d’inscrits ne reflète pas toujours l’importance d’une formation.
On nous a demandé de nous rapprocher des étudiants en créant des antennes locales, mais nous serons contraints de fermer certains de ces sites, ce qui est en totale contradiction avec les demandes des élus. Enfin, la baisse du budget notamment sur le volet « vie étudiante » induit moins d’investissements dans l’accompagnement, les infrastructures et les aides pour les jeunes.
| Coupes budgétaires pour l’Enseignement supérieur et la Recherche dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2025 Le 21 janvier 2025, le Sénat a validé une nouvelle coupe budgétaire de 630 millions d’euros pour l’enseignement supérieur et recherche, notamment l’université. Après une première réduction de 535 millions sur le plan « France 2030 », ces nouveaux coups de rabot touchent plusieurs secteurs, à savoir :
|
Que pensez-vous de la fusion du ministère de l’Éducation nationale et du ministère de l’Enseignement supérieur sous la direction d’Élisabeth Borne, avec un ministre délégué, Philippe Baptiste ?
Je le déplore fortement, et je suis loin d’être le seul. Un ministère dédié à l’Enseignement supérieur, à la Recherche et à l’Innovation permettait d’avoir une reconnaissance spécifique pour nos enjeux.
Désormais, nous sommes rattachés à l’Éducation nationale, ce qui réduit notre visibilité et notre poids politique. De plus, Philippe Baptiste n’est pas ministre à part entière, mais ministre délégué, ce qui affaiblit encore davantage notre représentativité.
Pendant ce temps, les États-Unis et la Chine investissent massivement dans la recherche et l’innovation, notamment en intelligence artificielle. L’Europe, elle, est à la traîne, et la France encore plus.
Nous attendons plus de stabilité, une vision stratégique claire et des moyens adaptés. Nous avons besoin que l’État clarifie le rôle des universités et arrête de nous placer dans une logique de concurrence malsaine. L’université doit être au cœur du système éducatif, pas un élément secondaire.
Nous devons sortir d’un modèle où seules les universités les plus riches s’en sortent. Il faut rééquilibrer le financement des établissements, avec un véritable contrat d’objectifs et de moyens. Sans cela, nous continuerons à voir des universités en difficulté, des formations supprimées et un système de recherche affaibli.