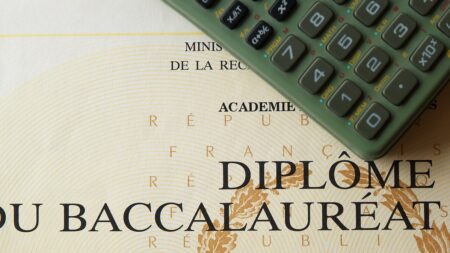Tu as appris tes fiches par cœur, mais ton cerveau panique, tes mains deviennent moites, ton estomac fait des loopings et tes jambes dansent la salsa ? Prends cinq minutes et respire : c'est tout à fait normal, le bac approche et cet examen peut en faire frémir plus d'un. Et rassure-toi : tu n'es pas seul. Depuis des générations, des milliers d’autres candidats ont ressenti ces sensations, à l’aube des épreuves de ce redoutable diplôme qui sonne le glas des années lycées.
Si tu ronchonnes à propos du bac, dis-toi que cette épreuve est une réelle institution française. Le baccalauréat existe depuis... le Moyen Âge ! Et oui, on parle d’un ancêtre bien plus vieux que ton prof d’histoire-géographie. Depuis sa création, il a changé mille fois, mais il est toujours là — fidèle au poste, version 2025. Alors lâche tes stylos et tes cahiers et assis-toi confortablement et instruis-toi avec nous ! Pour compléter tes connaissances sur la France d’hier, on va te conter l’étonnante histoire du baccalauréat.
Du Moyen-Âge à la révolution industrielle : baccalauréat, les origines
Alors que tu révises tes fiches de mathématiques, d'histoire, de philosophie ou de géographie, admet-le : tu pestes contre l’inventeur du baccalauréat. Mais qui a eu la terrible idée d’instaurer cet examen ? Mauvaise nouvelle : le coupable n'est pas seul. Le bac, c’est le résultat d’une longue évolution chaque siècle depuis l'époque médiévale. Il descend d’anciens diplômes aujourd’hui disparus, vestiges d’un autre temps.
Un peu d’étymologie, parce qu'on aime ça
Avant de plonger dans le grand bain de l’histoire du baccalauréat, petit focus sur le mot lui-même. En effet, le terme "Baccalauréat" provient du latin bacca laurea, autrement dit “couronne de laurier”. Tu penses à Jules César ? Bingo ! À l’époque, cette couronne était réservée aux héros et aux champions. Aujourd’hui, pas de couronne sur ta tête à la fin des épreuves hélas, mais décrocher le bac, c’est quand même une sacrée victoire. Et rassure-toi : c’est (un peu) moins violent qu'une guerre ou un combat de gladiateurs.
Le Moyen-Âge : le premier baccalauréat
C’est au XIIIe siècle qu’apparaît pour la première fois le bac, qui se divise alors en « filières ». Le Trivium (grammaire, rhétorique, dialectique) et le Quadrivium (arithmétique, géométrie, musique, astronomie). Si t’as fait du latin au collège et au lycée, ça doit te dire quelque chose.
À l'époque, ces enseignements étaient donnés à la fac, en particulier à l’université de Paris. Et spoiler alert : seuls les garçons entre 14 et 20 ans pouvaient passer le diplôme. Les filles ont dû attendre 700 ans pour avoir le droit d’y prétendre. Oui, tu as bien lu : 700 ans. À l’époque, avoir le baccalauréat permettait surtout… d’enseigner à l'université. En somme, le diplôme était était un mix entre notre licence actuelle et un doctorat.
De la Révolution Française à nos jours : le baccalauréat prend forme
On fait un bon dans le temps : à la Révolution Française de 1789, les universités sont supprimées. Mais qu’en est-il du bac ? Devine qui est derrière le diplôme que tu vas passer aujourd'hui ? C'est Napoléon Bonaparte. Oui oui, le fameux, qui entre deux conquêtes, a aussi pensé à organiser l’éducation. En 1808, il crée un baccalauréat national, avec une idée simple : former les futures élites de l’Empire.
Sous le 1er Empire, ce diplôme devient un grade d’État qui va parachever les études secondaires et donner accès à l’enseignement supérieur. En 1809 se déroule la première édition du bachot (ancienne appellation du bac) uniquement composé d’épreuves orales avec cinq disciplines : droit, lettres, médecine, sciences, théologie. 31 candidats obtiennent le diplôme.
Les épreuves écrites pointent le bout de leur nez
Vingt ans plus tard, en 1830, les premières épreuves écrites apparaissent/ Mais à ce moment-là, toujours pas de notes ! Les candidats sont classés par mentions : de "très bien" à… "mal". Eh oui la "mention mal" c’était un vrai critère, et non, ça ne passait pas très bien sur un CV.
Dès l'année 1840, le mot "programme" entre dans le vocabulaire du bac : les jurys peuvent désormais poser des questions précises sur des auteurs et des œuvres. Petit à petit, le bac se structure.
Le coup de balai de Jules Ferry et les grandes réformes
À la fin du XIXe siècle, le baccalauréat se généralise et compte chaque année plusieurs centaines de candidats. Mais un certain Jules Ferry, célèbre dans le domaine de l’éducation et star de la réforme scolaire, vient bouleverser l’existant. Pour lui, l’examen devenu obsolète par rapport aux besoins de l’époque et décide de tout revoir.
Il commence par remplacer en 1881 les oraux, alors orientés sur des œuvres latines et grecques, par des sujets de français et d’histoire. Et il établit en 1890 le fameux système de notation que l’on connaît aujourd’hui, allant de 0 à 20 points. Merci Jules Ferry !
En 1901, il devient impossible de tricher au bac (du moins, officiellement). La première loi qualifiant la fraude à l’examen du bac comme étant un délit est adoptée.
1924 : Les femmes peuvent (enfin) passer le bac
On t’en a parlé plus tôt : il aura fallu 700 ans pour que les femmes aient le droit de passer le bac. nous sommes désormais en 1924, et les femmes peuvent maintenant passer l’examen du baccalauréat. Eh oui, cela fait seulement un siècle que c'est le cas ! Un grand tournant dans la société française !
Mais avant ça, une pionnière a brisé les codes : Julie-Victoire Daubié, journaliste et militante pour le droit des femmes. Elle a eu la possibilité de passer son baccalauréat le 16 août 1861 à 37 ans à la faculté des Lettres de Lyon, appuyée par l’Impératrice Eugénie. Moralité : le réseau, c’est (déjà) la clé.
Histoire insolite : En 2004, un candidat a tenté de tricher au bac en se faisant tatouer des formules de physique-chimie sur son avant-bras. Sa supercherie a été démasquée et cet élève a été interdit d'examen pendant cinq ans.
2018 : Parcoursup rebat les cartes dans l'accès aux études supérieures
Les années se sont écoulées et le baccalauréat s’est popularisé, en passant de diplôme réservé à l’élite française à certification nécessaire à tout début de carrière professionnelle. Au cours des dernières décennies, quelques changements ont été apportés au baccalauréat. Aujourd’hui, c’est un vrai passage obligé pour entrer dans la vie étudiante.
Néanmoins, depuis l’élection du président de la République, Emmanuel Macron en 2017, le diplôme a considérablement changé, notamment avec la réforme du lycée et du baccalauréat, portée par l’ancien ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
La première étape dans le quinquennat du président, c’est l’arrivée de la plateforme Parcoursup qui remplace Admission Post-Bac (APB) le 15 janvier 2018, dans le cadre du Plan étudiant. Avant, APB fonctionnait à coup de tirages au sort et d’algorithmes. Avec Parcoursup, tu peux formuler jusqu’à 10 vœux (contre 24 avant), rédiger un CV, une lettre de motivation pour chaque formation, et envoyer tes bulletins de première et terminale. Et ce ne sont plus les algorithmes, mais les établissements eux-mêmes qui choisissent les candidats.
De même, le dossier de candidature de préparation pour les études supérieures change aussi. Dans chaque établissement souhaité, le lycéen rédige un CV et une lettre de motivation, puis il doit fournir les bulletins scolaires de première et de terminale. Dernière grande nouveauté, ce sont les établissements eux-mêmes qui envoient des réponses positives ou négatives.
2019 : Réforme du lycée et du baccalauréat
En 2019, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, revoit en profondeur le fonctionnement du lycée et du baccalauréat.
Objectif : rendre le bac plus personnalisé et plus adapté à ton projet. Fini les séries L, ES, S en série générale et place aux enseignements de spécialité. Ainsi, les élèves qui sont entrés en seconde à la rentrée 2018 sont ceux qui passent le nouveau baccalauréat en juin 2021, et donc les premiers concernés par cette réforme.
Désormais, à la fin de la seconde, tu choisis 3 spécialités parmi les 13 enseignements possibles en classe de première, puis tu n’en gardes que 2 en terminale.
Voici les 13 spécialités du baccalauréat général :
- Humanités, littérature et philosophie (HLP)
- Arts (Histoire des arts, théâtre, arts plastiques, arts du spectacle, arts du cirque, danse, musique, cinéma audiovisuel)
- Biologie & écologie (dans les lycées agricoles seulement)
- Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences politiques (HGGSP)
- Langues Littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) avec comme langue au choix : anglais, anglais monde contemporain, allemand, espagnol, italien
- Littérature, Langues et culture de l’Antiquité (LLCA)
- Mathématiques
- Numérique et Sciences informatiques (NSI)
- Physique-Chimie
- Sciences de la vie de la Terre (SVT)
- Sciences de l’ingénieur (SI)
- Sciences économiques et sociales (SES)
En outre, la réforme du baccalauréat inclut d’importantes modifications. D’une part, la réduction du nombre d’épreuves en terminale : elles sont désormais au nombre de 4, avec l’épreuve de philosophie, deux épreuves écrites de spécialité qui sont passées au retour des vacances de printemps et le grand oral, nouvelle épreuve phare de la réforme. L’oral et l’écrit de français en fin de première sont maintenus.
À cela s’ajoutent les épreuves de français (écrit + oral) en fin de première. Le reste des matières est évalué en contrôle continu, notamment via les épreuves communes (EC), réparties sur la première et la terminale. Ces EC concernent :
- L’histoire-géographie
- Les langues vivantes
- L’enseignement scientifique (voie générale) ou les maths (voie technologique)
- La spécialité abandonnée en terminale
En bref, ton dossier est évalué en continu, ce qui rend l’année plus équilibrée… ou plus intense, selon ton point de vue !
2020 : Premier baccalauréat en contrôle continu
Et là, bim : crise sanitaire mondiale. En 2020, la réforme du bac s’installe progressivement dans les lycées, mais l’épidémie de Covid-19 arrive en France et se développe à vitesse grand V, ce qui entraîne la fermeture des établissements scolaires, le 16 mars 2020. Par conséquent, les lycéens découvrent les cours à distance et la continuité pédagogique.
Quelques jours plus tard, le 3 avril, Jean-Michel Blanquer annonce que l’ensemble des épreuves du baccalauréat sont annulées et remplacées par du contrôle continu. La dernière édition de l’ancien bac n’aura donc jamais lieu. La dernière fois que les épreuves avaient connu des bouleversements, c’était en 1968, lors de violentes manifestations étudiantes. Cette annulation des épreuves a eu un effet exceptionnel sur le taux de réussite, avec 95,7 % d’admis (contre 88,1 % en 2019). C’est du jamais vu !
En 2021, le “bac nouvelle génération” devait enfin voir le jour… mais la crise sanitaire liée au Covid-19 est toujours là. Résultat des courses : les épreuves communes et de spécialité sont à nouveau annulées, au profit du contrôle continu. Seuls survivent le français (en première), la philo et le grand oral. Un lancement... un peu chamboulé.
2025 : Le baccalauréat aujourd’hui
Cette année, la réforme bat son plein et sa cinquième génération de lycéens de la « nouvelle formule », initié par l’ancien ministre de l’Éducation nationale. Les épreuves de spécialité se déroulent de nouveau au mois de juin, qui comptent pour un tiers de leur note du bac, après le report en mars. De cette façon, les résultats de ces examens étaient pris en compte dans les dossiers de candidature du lycéen sur Parcoursup. Le gouvernement a rétropédalé l'année dernière, après le désaccord des syndicats du secondaire, accompagnés par les enseignants et la communauté éducative.
Alors, quelle sera la prochaine étape ? Un nouveau calendrier ? Un retour aux anciennes séries ? Une refonte complète du bac ? Difficile à dire. Une chose est certaine : l’histoire du baccalauréat continue de s’écrire… et ce n’est pas près de s’arrêter.