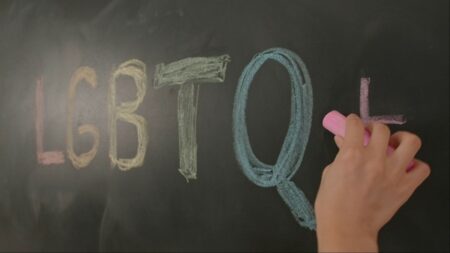La Charte d’Engagement LGBT+ a été lancée en 2022 auprès des établissements de l’enseignement supérieur. Il s’agit d’une déclinaison de la Charte du même nom, déployée dans le monde du travail et qui existe depuis 2013. Elles sont toutes les deux portées par l’association L’Autre Cercle. À quoi servent-elles dans le milieu académique ? Quelles sont les missions qu’elles défendent ? Diplomeo te répond !
Promouvoir un environnement inclusif dans l’univers académique
L’extension de la Charte d’Engagement LGBT+ au milieu académique est le fait de l’association L’Autre Cercle, en partenariat avec le Caélif (Collectif des associations étudiantes LGBT+ d’Île-de-France) et la FAGE (Fédération des Associations Générales Etudiantes), avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur et de L’Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l’enseignement supérieur.
La Charte n’est pas imposée. Ce sont les universités et écoles qui décident de la signer ou non. Toutefois, les établissements signataires s’engagent à mener à bien plusieurs missions :
- Créer un environnement inclusif pour le personnel, les enseignants et les étudiants LGBT+
- Veiller à une égalité de droit et de traitement quelle que soit l’orientation sexuelle ou l’identité de genre
- Soutenir le personnel, les enseignants et les étudiants victimes de propos ou d’actes discriminatoires
- Mesurer les avancées et partager les bonnes pratiques pour faire évoluer l’environnement professionnel et le cadre d’études dans l’enseignement supérieur
« Avec la création de cette charte, nous avons voulu poser un cadre clair et spécifique pour les établissements d’enseignement supérieur, afin de développer un environnement de travail et d’études qui soit inclusif et bienveillant », explique Charles-François Perrone, animateur de Charte d’Engagement LGBT+ de l’Enseignement Supérieur.
Concrètement, quelles actions ?
Les établissements signataires de la Charte d’Engagement LGBT+ ne s’engagent pas seulement à signer électroniquement un document. Le processus de signature est assez complexe et implique plusieurs actions à réaliser en amont :
- Étape n°1 : l’établissement signataire réalise quatre réunions de travail, en interne, pour « préparer un plan d’actions concrètes à mettre en œuvre »
- Étape n°2 : ce plan d’action et un dossier de candidature sont envoyés à un Comité de validation, puis L’Autre Cercle informe l’établissement de sa décision
- Étape n°3 : une cérémonie de signature est organisée en présentiel ou en ligne, à laquelle participent le président de l’établissement signataire, les représentants de L’Autre Cercle et éventuellement des représentants d’étudiants
À noter également que la Charte prévoit un suivi des actions réalisées du côté des universités et écoles engagées. Il prend la forme de réunions de partage de bonnes pratiques. Par ailleurs, l’engagement n’est valide que pour trois années, au moment de la signature. Une fois ce temps écoulé, l’établissement se concerte avec L’Autre Cercle pour reconduire ou non son titre de signataire.
🔎 D’un établissement à l’autre, les actions ne sont pas les mêmes. Il peut s’agir d’avoir recours à l’écriture inclusive dans les documents administratifs, de permettre aux étudiants en transition d’utiliser un prénom usuel, de créer des cellules EDI (Égalité Diversité Inclusion) sur les campus ou de mettre à disposition des modules d’information et de formation autour des questions LGBTQIA +, en ligne, par exemple.